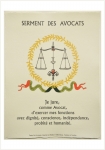19 décembre 2025
Un mandataire n’est pas le bénéficiaire effectif .la résidence fiscale de celui-ci doit être prouvée (CAA Versailles 15.11.22 Performing Rights Society Ltd

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE .
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;Les deux approches du CE :
Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
Société relais et bénéficiaire effectif
( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE
La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd (PRS) est un organisme anglais, créé en 1914, de gestion collective de droits des auteurs et compositeurs dans le domaine de la musique, ainsi que de maisons discographiques
Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de PRS des droits à hauteur de respectivement 8 313 244 et 21 784 126 euros. Avant de les reverser à PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33, 3 %.
Le taux de la RAS de l article 182B est à ce jour celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.(25%°
La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant de ce qu’en vertu de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, les redevances, entendues comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son Etat de résidence, soit le Royaume-Uni.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles en date des 12 mars et 18 juin 2019 rejetant ses appels contre ces deux jugements.
Dans sa décision le conseil Etat confirme la position de la DGFIP,et ne suivant pas les conclusions du rapporteur public casse avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles
CE N° 430594-432845 10ème et 9ème CR 5 février 2021
Société Performing Rights Society Ltd.(PRS
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
(non suivies par le CE )
La CAA de Versailles confirme l imposition
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2022, 21VE00440, Inédit au recueil Lebo ...
La preuve de la résidence fiscale des bénéficiaires effectifs DOIT ETRE JUSTIFIEE
Toutefois, pour justifier de la résidence fiscale de ses membres et du montant des redevances qu'elle leur a versées, la société se borne à produire des tableaux de répartition par pays et des listes comportant le nom, le pays, le montant de la redevance versée, le montant des retenue subie et réclamée et l'adresse de ses membres non-résidents fiscaux britanniques.
Les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés.
Par ailleurs, la société ne justifie pas, par la production de tableaux établis par elle-même non étayés de documents comptables, des montants versés. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les redevances qu'elle dit avoir versées à ces membres étaient éligibles à une exonération conventionnelle.
14:43 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
18 décembre 2025
cour des comptes rapport sur la lutte contre la fraude fiscale ( decembre 2025)
 L'administration a beau avoir fait évoluer ses techniques de lutte contre la fraude fiscale, ses efforts ne se traduisent pas dans les chiffres, déplore la Cour des comptes.
L'administration a beau avoir fait évoluer ses techniques de lutte contre la fraude fiscale, ses efforts ne se traduisent pas dans les chiffres, déplore la Cour des comptes.
Dans un rapport publié mardi 16 decembre 2025, les magistrats s'étonnent du décalage entre les nombreuses lois (2013, 2018), articles de lois de finances (de 2019 à 2021) ou plan contre la fraude (en 2023) qui se sont succédé en dix ans et les résultats de cette lutte
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES
SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ( 12-25)
Alors que les recettes des impôts et taxes encaissées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont bondi de 44 % ces dix dernières années, pour atteindre 718 milliards d'euros en 2024, les résultats du contrôle fiscal n'ont pas du tout suivi la même trajectoire. Les sommes mises en recouvrement avoisinent toujours 20 milliards d'euros, avec même un léger recul (20,1 milliards en 2024, contre 21,2 milliards en 2015). Et les sommes réellement recouvrées en représentent toujours à peine une grosse moitié (11, 4 milliards d'euros en 2024, contre 12,2 milliards en 2015).
L'administration n'a pourtant pas chômé pour se mettre au goût du jour. Elle a déployé notamment de nouveaux outils informatiques, facilité l'échange d'information et durci à plusieurs reprises la législation antifraude. Tirant parti de la massification des données, le fisc a cherché à mieux cibler ses contrôles sur les dossiers à forts enjeux, en déployant des techniques de croisement de données (anomalies, irrégularités), ou « data mining », désormais à l'origine de plus de la moitié des contrôles.
Lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres plf 2026
La fraude et le contrôle fiscal
Certains se demandent si ce rapport n’est pas volontairement provocateur pour renforcer les contrôles fiscaux et sociaux et ce dans la cadre duProjet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales en cours de votation
Par ailleurs , la cour omet de signaler qu elle refuse de controler la legalite des rescrits publics ou individuels ???
Le rescrit d imposition des membres du conseil constitutionnel
est il légal ??
Il y une quarantaine d’années , la lutte contre la fraude fiscale visait d’abord la fraude fiscale interne dite de quartier ou de voisinage
"Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt...Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."
Depuis cette epoque et la libéralisation generalisee des échanges financiers le MINEFI a pris conscience que les règles européennes ont permis le développement d’une fraude de forte ampleur financière ,économique et sociale mais a aussi a forte organisation mais dont le contrôle est chronophage tant pour l'administration que pour les contribuables ??
Lutte contre la fraude fiscale internationale des résultats en hausse en 2024-pdf
De même ce n’est que depuis le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON qui a rappelé la règle budgétaire que l efficacité du contrôle ne se mesurait pas au nombre et au montant des redressements mais d’abord au montant des encaissements effectifs ,la politique du NIP (le Net In the Pocket) est alors née
Une premiere recommandation politique a été diffusée en juin 2009
La recherche de la preuve est le premier maillon
de la chaîne du contrôle fiscal /par E Woerth
Bercy juin 2009
Depuis cette date de très nombreuses mesures ont été prises tant au niveau interne qu'au niveau international
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale
En outre, la politique de répression pénale des services fiscaux est ciblée sur les fraudes faciles à sanctionner et non sur les plus répréhensibles. En 2008, près du tiers des plaintes visait des entrepreneurs du bâtiment. En revanche, les dépôts de plainte visant les grandes entreprises ou des particuliers "à fort enjeu" sont extrêmement rares, les services fiscaux préférant passer par des transactions pour éviter une confrontation avec des contribuables dotés de conseils juridiques puissants. (Rapport page 11)
Bercy fait face à un paradoxe. En dix ans, les outils de lutte contre la fraude fiscale se sont singulièrement étoffés. Progression des échanges avec des États étrangers, meilleur partage des informations entre les différentes administrations en France, ou encore développement de nouvelles techniques numériques de détection automatique, le fisc est mieux équipé qu’il ne l’était il n’y a quelques années. Et pourtant, le bilan reste « mitigé », selon le rapport de la Cour des comptes rendu public ce 16 décembre.
« La connaissance de l’ampleur de la fraude commise n’a pas progressé, les résultats financiers du contrôle fiscal en droits rappelés et pénalités, à hauteur de 20 milliards d’euros en 2024, peinent à retrouver leur niveau du milieu des années 2010, et à rebours de l’intention affichée du législateur, la fraude fiscale n’est ni plus fréquemment, ni plus durement sanctionnée qu’il y a dix ans », relève le rapport.
Légère diminution des sommes récupérées par le fisc
En 2015, le résultat du contrôle se chiffrait à 21,2 milliards d’euros en 2015. Les sommes réellement récupérées par le fisc ont même eu tendance à légèrement diminuer, passant de 12,2 milliards d’euros en 2015 à 11,4 milliards d’euros en 2024.
Cette stagnation des résultats financiers interroge, malgré d’adoption de nouveaux outils, et la croissance générale des recettes fiscales. Dans la décennie 2013-2023, le volume des impôts collectés a progressé de 44 % pour atteindre 718 milliards d’euros, ce qui rend d’autant plus contre-intuitif la stagnation du produit de la lutte contre la fraude fiscale.
L’administration fiscale n’est pas en mesure de l’expliquer. « Faute d’une estimation robuste de l’écart fiscal (fraude, les erreurs de bonne foi et les aléas de recouvrement, ndlr), il n’est pas possible d’évaluer la performance du contrôle fiscal », écrivent les auteurs du rapport. L’absence d’estimation reste à leurs yeux une « carence regrettable ».
« Affirmer, comme certains, que la fraude fiscale représente entre 80 et 100 milliards d’euros, c’est une affirmation quasi-gratuite »
Pour le premier président de la Cour des comptes, la fraude fiscale reste un phénomène « mal cerné, mal chiffré, mal traité ». « Ce rapport ne livre pas le chiffre magique que tout le monde attend […] Affirmer comme certains que la fraude fiscale représente entre 80 et 100 milliards d’euros, c’est au minimum une approximation, c’est en réalité une affirmation quasi gratuite », a-t-il également souligné face à la presse ce matin. La Cour des comptes recommande de réaliser au plus vite une estimation, considérant que la France affiche un retard en la matière au sein des pays de l’OCDE.
« Il est indispensable que la direction générale des finances publiques termine son estimation de l’écart fiscal de la TVA et estime celui relatif à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu d’ici 2027. Ces estimations doivent devenir un chantier prioritaire », plaide la Cour des comptes.
L’efficacité de la stratégie numérique « a encore besoin d’être étayée »
Le rapport revient également sur la montée en charge ces dernières années de l’automatisation de la détection d’anomalies déclaratives, à travers les techniques de croisement des données en masse (data mining) mises en place à partir de 2018. L’administration fiscale s’était donné pour objectif de programmer 50 % de ses contrôles sur ce principe, objectif atteint dès 2022 s’agissant des contrôles des professionnels. La cible pour les particuliers pourrait être atteinte prochainement.
Ce type de technique, devenue d’un des piliers de la stratégie de lutte contre la fraude, ne représente pourtant que 13,8 % des droits et des pénalités recouvrés en 2023. « S’il est acquis que cette stratégie numérique apporte des gains d’efficience en matière de programmation des contrôles, son efficacité a encore besoin d’être étayée », suggère la Cour des comptes. L’une des autres évolutions majeures de la période récente est la diminution des efforts affectés au contrôle : ces derniers ont fondu de 19 % entre 2015 et 2024, ce qui a amené la Direction générale des finances publiques à privilégier des contrôles ciblés, et à se recentrer sur les dossiers « à forts enjeux », notent les auteurs.
« La réponse pénale est moins répressive qu’attendu »
Autre évolution passée au crible par la Cour des comptes : celle de la politique de répression. L’administration a tendance à favoriser les résolutions à l’amiable, une façon de faciliter le recouvrement des créances et à éviter les contentieux, longs et donc incertains. Le législateur a en parallèle, en 2018, réformé le « verrou de Bercy », système qui donnait au fisc le monopole des poursuites pénales en cas de fraude. La loi du 23 octobre 2018 a rendu obligatoire la transmission au parquet des dossiers comportant plus de 100 000 euros de droits rappelés.
Cette réforme s’est bien traduite par une hausse des dénonciations fiscales, passant de 935 avant 2018 à 2 176 en 2024. Les condamnations sont cependant restées numériquement stables (de l’ordre de 650 par an), la part des peines d’emprisonnement ferme diminue légèrement, et le montant moyen des amendes progresse. Mais 44 % des affaires de fraude fiscale ont fait l’objet d’un classement sans suite, et seules 27 % ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, soit moins qu’avant la réforme. La Cour des comptes « observe ainsi que, malgré l’augmentation des signalements, la réponse pénale est globalement moins répressive qu’attendu ». Elle appelle à réaliser l’an prochain un bilan de la réforme du « verrou de Bercy ».
10:41 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
15 décembre 2025
La Résidence Fiscale Internationale : Analyse des Critères Internes et Conventionnels
 patrickmichaud@orange.fr – Tel : 0607269708
patrickmichaud@orange.fr – Tel : 0607269708
La notion de résidence fiscale internationale permet de déterminer dans quel État une personne est considérée comme résidente à des fins fiscales, et donc soumise à une imposition soit mondiale (sur l’ensemble de ses revenus) soit restreinte (seulement sur les revenus de source locale). Cette qualification conditionne l’application des règles de territorialité, la lutte contre la double imposition et l’application des conventions fiscales bilatérales. Dans un contexte d’expatriation, de mobilité professionnelle et de patrimoines internationaux, la détermination du domicile fiscal revêt une importance majeure. En cas de double domiciliation apparente, les conventions fiscales – principalement inspirées du Modèle OCDE – viennent départager les États concernés et désigner un unique État de résidence fiscale.
Cet article présente successivement les règles internes françaises, les critères conventionnels de départage issus du Modèle OCDE (voir la mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE – lien : https://www.oecd.org/fr/publications/la-mise-a-jour-2025-du-modele-de-convention-fiscale-de-l-ocde_472b60f7-fr.html
– ainsi que les commentaires OCDE de 2017 sur la notion de domicile fiscal), puis analyse les principales jurisprudences pertinentes. Enfin, un aperçu des règles en vigueur dans quelques pays étrangers est proposé, avant un encadré récapitulatif des critères OCDE.
La mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
I. Principe de supériorité et de subsidiarité des conventions fiscales
En droit français, une convention fiscale internationale (conclue pour éviter les doubles impositions) a une valeur supérieure à la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution (principe de supériorité). Elle peut écarter la loi fiscale nationale sur tel ou tel point, mais elle ne peut jamais, à elle seule, créer l’imposition. Autrement dit, une convention fiscale n’est pas une base légale d’imposition autonome. Le Conseil d’État, dans un arrêt de principe (CE, Ass., 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276), a clairement établi la méthode en deux temps :
- Application de la loi interne – Il faut d’abord vérifier, au regard du droit fiscal interne (français), si l’imposition contestée est fondée. En d’autres termes, la France est-elle compétente pour imposer ce revenu selon sa propre loi fiscale ? Si oui, sur quelle base (quelle qualification fiscale) ?
- Vérification de la convention fiscale – Ensuite, il convient de confronter cette qualification aux stipulations de la convention fiscale applicable afin de déterminer si la convention fait obstacle ou non à l’imposition. Le juge doit rechercher si la convention bilatérale empêche la France d’imposer ce contribuable (principe de subsidiarité de la convention).
Le Conseil d’État rappelle ainsi que la convention ne constitue jamais une base d’imposition autonome : il faut toujours appliquer d’abord la loi interne, puis seulement ensuite vérifier si la convention internationale écarte cette imposition. L’arrêt Schneider Electric précité (CE 28/06/2002) est la décision fondamentale illustrant ce principe, confirmé par une décision ultérieure (CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583). Ces arrêts consacrent donc cette logique en deux temps pour traiter les situations de double imposition.
Décision fondamentale :
CE, Assemblée, 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276
Décision complémentaire :
CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583
II. Les critères de la résidence fiscale
La détermination de la résidence fiscale repose sur deux niveaux de critères : d’une part, les critères définis par le droit interne (dans chaque pays) et, d’autre part, les critères prévus par les conventions fiscales internationales (traités bilatéraux). En France, la loi fiscale interne fixe des critères alternatifs pour le domicile fiscal, tandis que les conventions fiscales appliquent des critères hiérarchisés pour départager deux États.
A. Les critères de résidence fiscale en droit interne (France)
En droit français, les critères du domicile fiscal figurent à l’article 4 B du Code général des impôts (CGI). Selon ce texte, une personne physique est considérée comme résidente fiscale française dès lors qu’elle remplit au moins un des critères suivants :
Le choix des critères est libre c'est-à-dire que l administration peut choisir le critère le plus favorable tel que l articel 4B CGI les determine
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
- Foyer ou séjour principal en France : la personne a en France son foyer (lieu où vit sa famille habituellement) ou le lieu de son séjour principal (c’est-à-dire qu’elle séjourne en France plus de la moitié de l’année, de manière habituelle).
Par exemple, un contribuable ayant séjourné 302 jours en France a été considéré comme résident (CE 5 juillet 1961, n°37182) : - Activité professionnelle en France : elle exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elle ne prouve que cette activité y est exercée à titre accessoire seulement.
- Centre des intérêts économiques : elle a en France le centre de ses intérêts économiques, c’est-à-dire l’essentiel de ses affaires, investissements, sources de revenus ou de son patrimoine.
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- Fonctionnaire ou agent de l’État en poste à l’étranger : les agents de l’État français qui exercent leurs fonctions ou sont en mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus sont considérés comme résidents fiscaux français.
Important : Ces critères sont alternatifs et non hiérarchisés – il suffit d’en remplir un seul pour être domicilié fiscalement en France. L’administration fiscale est libre d’invoquer le critère qui lui est le plus favorable pour établir la résidence fiscale d’un contribuable. Par exemple, un contribuable qui séjourne 302 jours en France sur une année a été considéré comme résident fiscal français (CE, 5 juillet 1961, n°37182). Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP du 28 juillet 2016) commente en détail chacun de ces critères et la jurisprudence les illustre régulièrement.
Le BOFiP commente longuement ces critères :
Lorsque l’application de ces critères internes désigne la France comme pays de résidence fiscale mais qu’un autre État revendique également la résidence de la même personne selon ses propres critères, alors intervient le second niveau : les critères conventionnels de départage (prévus par les conventions fiscales).
B. Les critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE)
Les conventions fiscales bilatérales, qui visent notamment à éviter les doubles impositions, s’inspirent généralement du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (article 4 du Modèle OCDE). En cas de double résidence (une personne considérée résidente des deux États selon chaque législation interne), la convention prévoit une série de critères hiérarchisés pour ne retenir qu’un seul État de résidence fiscale. Les critères de départage du Modèle OCDE (mise à jour 2017 et 2025) sont appliqués dans l’ordre, le premier remplissant excluant les suivants :
- Foyer d’habitation permanent : Si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans un seul des deux États, elle est réputée résidente uniquement de cet État-là. (C’est le critère principal : le lieu du foyer permanent).
- Centre des intérêts vitaux : Si elle possède un foyer permanent dans les deux États (ou n’en possède aucun), on examine dans quel État se situent ses liens personnels et économiques les plus étroits. Le pays avec lequel elle a le plus fort rattachement (famille, activités, patrimoine…), c’est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux, sera son seul État de résidence. (À noter : la jurisprudence a pu affiner la notion d’intérêts vitaux, incluant par exemple la localisation indirecte de certaines sources de revenus – v. l’affaire Tedesco, CE 26/09/2012, sur le centre d’intérêt économique indirect).
- Séjour habituel : Si le centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher (par exemple des liens équilibrés des deux côtés) ou si la personne ne dispose d’aucun foyer permanent dans l’un ou l’autre État, on regarde où elle séjourne de façon habituelle. Cela revient à déterminer dans lequel des deux pays elle passe habituellement le plus de temps sur une période donnée. Le Conseil d’État a précisé que la notion de séjour habituel n’est pas strictement une question de dépasser ou non 183 jours, mais bien d’identifier le lieu où la personne vit de façon régulière (CE, 16 juillet 2020, n°436570, concl. Ciavaldini).
- Nationalité : Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si au contraire elle ne réside habituellement dans aucun des deux, on utilise le critère de la nationalité. Elle est considérée comme résidente fiscale uniquement de l’État dont elle possède la nationalité. (En cas de double nationalité, ce critère ne permet pas de conclure et on passe au suivant.)
- Procédure amiable entre administrations : Enfin, si la personne possède la double nationalité des deux États contractants ou si elle n’a la nationalité d’aucun des deux, la convention prévoit généralement que les autorités compétentes des deux pays doivent se consulter pour trancher d’un commun accord la question de la résidence (appelée procédure amiable ou Mutual Agreement Procedure).
Ces critères de tie-breaker internationaux sont strictement hiérarchiques : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne permet pas de départager les deux pays. À noter que, pour les personnes morales (sociétés), les conventions prévoient souvent un critère spécifique de résidence fiscale unique (par exemple le lieu du siège de direction effective de l’entreprise).
Illustration jurisprudentielle: Dans une décision du 17 mars 2016 (CE, 3e/8e SSR, n°383335, aff. Curot), relative à un contribuable franco-russe, le Conseil d’État a appliqué pas à pas ces règles de départage. L’arrêt souligne qu’en droit interne français les critères de domiciliation fiscale ne sont pas hiérarchisés (l’administration peut choisir le critère approprié de l’article 4 B CGI pour établir la résidence), alors qu’en droit conventionnel les critères sont ordonnés tel que listé ci-dessus. Cette hiérarchie a donc vocation à s’appliquer dès qu’un contribuable est a priori résident des deux pays selon chaque législation nationale.
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
III. Double imposition et rôle des conventions fiscales
La problématique de la double imposition surgit lorsque deux États considèrent chacun un même contribuable comme résident fiscal chez eux (ou qu’ils s’attribuent le droit d’imposer les mêmes revenus). Les conventions fiscales jouent un rôle essentiel de « soupape » dans ces situations : en plus des critères de résidence unique, elles prévoient des mécanismes pour éviter qu’un même revenu soit taxé deux fois. Une fois l’État de résidence unique déterminé, l’autre État est généralement contraint par la convention de limiter son imposition (par exemple via l’exemption de certains revenus ou l’octroi d’un crédit d’impôt imputable). Ainsi, les conventions assurent une coordination entre législations fiscales : elles répartissent les droits d’imposer entre pays et organisent l’élimination des doubles impositions. En France, l’application de ces conventions est d’autant plus cruciale que, comme vu précédemment, un résident fiscal français est imposé sur ses revenus mondiaux. Les conventions viennent éviter qu’un revenu de source étrangère soit imposé deux fois (une fois en France du fait de la mondialité, et une fois dans le pays source).
En pratique, lorsqu’un contribuable est imposable en France selon la loi interne, mais que la convention attribue la résidence fiscale à un autre État ou limite le droit d’imposer de la France, l’administration française doit s’incliner devant la convention (principe de supériorité). Par exemple, si une convention désigne l’autre pays comme État de résidence unique, la France devra traiter le contribuable comme non-résident fiscal (même s’il remplirait un critère interne) et ne pourra imposer que les revenus de source française explicitement taxables par un non-résident. Les conventions prévoient également des procédures amiables pour régler les désaccords ou situations non prévues, garantissant une résolution coordonnée des cas de double imposition.
(Voir la Liste des conventions fiscales signées par la France
iste des conventions fiscales signées par la France
sur le site du ministère des Finances – lien : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1910-PGP.html/identifiant=BOI-INT-DG-20-20-20-20190703 – et les textes intégraux des conventions sur le site impots.gouv.fr.)
IV. Conclusion
En résumé, la résidence fiscale internationale se trouve au croisement du droit interne et du droit conventionnel. En droit français, les critères du domicile fiscal (foyer, séjour principal, activité, intérêts économiques, etc.) sont alternatifs et cumulatifs dans leur application (l’administration peut choisir le critère qui convient pour établir la résidence). En revanche, en droit conventionnel, les critères de départage inspirés du Modèle OCDE sont strictement hiérarchisés et s’appliquent successivement pour ne retenir qu’un seul pays de résidence en cas de conflit. La jurisprudence (Schneider Electric, Tedesco, Curot, etc.) fournit des clés précieuses pour interpréter et appliquer ces règles dans des situations concrètes.
Au-delà d’une simple notion administrative, la qualification de la résidence fiscale emporte des conséquences très importantes. En effet, le statut de résident fiscal conditionne directement :
- L’imposition mondiale des revenus (obligation fiscale illimitée du résident sur l’ensemble de ses revenus où qu’ils soient produits) ;
- La prévention de la double imposition (via l’application des conventions fiscales, crédits d’impôt, exemptions…) ;
- La mobilité internationale des travailleurs et des capitaux (optimisation fiscale, choix d’expatriation, détachement, etc.) ;
- D’importants enjeux successoraux et patrimoniaux (règles de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune, etc., qui dépendent du lieu de résidence fiscale).
- ATTENTION ; a defaut de convention fiscale sur les successions, la residence fiscale IR peut ne pas correspondre à la definion fiscale successorale
Comprendre et maîtriser ces critères de résidence fiscale est donc indispensable pour tout contribuable ou conseiller fiscal confronté à des situations transfrontalières. Une bonne qualification du domicile fiscal permet d’assurer une imposition conforme aux lois et aux traités, d’éviter les mauvaises surprises (double imposition non éliminée, requalification rétroactive de résidence par une administration, redressements) et de bénéficier au mieux des dispositions offertes par les conventions internationales.
Encadré récapitulatif – Critères de départage OCDE en cas de double résidence (résumé) :
- Foyer d’habitation permanent – Le pays où le contribuable dispose d’un foyer permanent l’emporte.
- Centre des intérêts vitaux – Si foyer dans les deux pays, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits l’emporte.
- Séjour habituel – Si les intérêts vitaux ne permettent pas de trancher, le pays où la personne séjourne habituellement (passe la majorité de son temps) l’emporte.
- Nationalité – Si séjour habituel dans les deux ou aucun, le pays dont la personne a la nationalité l’emporte.
- Procédure amiable – En dernier recours (double nationalité ou aucune), les administrations fiscales doivent trouver un accord amiable pour désigner l’État de résidence.
11:18 | Tags : la résidence fiscale internationale : analyse des critères inter | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
11 décembre 2025
Un quasi-usufruit peut-il constituer une réappropriation des biens donnés ? (CE 14/10/25 conc CORTOT BOUCHER
 La loi française permet de purger l’impôt sur les plus values potentielles en cas de donation de biens meubles ou immeubles. En cas de cessions ultérieures à la donation, la plus value de cession est en effet calculée par rapport à un prix de revient égal en principe à la valeur de la donation des biens cédés à titre onéreux
La loi française permet de purger l’impôt sur les plus values potentielles en cas de donation de biens meubles ou immeubles. En cas de cessions ultérieures à la donation, la plus value de cession est en effet calculée par rapport à un prix de revient égal en principe à la valeur de la donation des biens cédés à titre onéreux
La pratique est donc de procéder à une véritable donation suivie d’une véritable cession pat le donataire pour purger l'impôt sur les plus values de cession
Le BOFIP sur le prix d’acquisition à titre gratuit
Cette pratique acceptée par la doctrine et la jurisprudence doit respecter scrupuleusement les règles légales du code civil et le principe de Loiseul ; donner et retenir ne vaut
mais quelle est la position de l'administration en cas de quasi usufruit ??
une autre pratique est de donner la nue propriete et l usufruitier se distribue les reserves dans le cadre d un quasi usufruit ??
Un quasi-usufruit peut-il constituer une réappropriation des biens donnés ?
L’article 894 du code civil : “ La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte
L’article 578 du même code : “ L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance “ ;
l’article 581 du code civil l’usufruit “ peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles “ ;
et aux termes de l’article 587 du même code : “ Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée
C’est cette dernière disposition , appelée quasi usufruit , qui a fait l objet d’un arrêt défavorable pour le contribuable de la CAA de LYON
C A A de LYON N° 12LY02321 7 novembre 2013
Cet arret a fait l objet d une decision de confirmation sans renvoi
Conseil d'État N° 374440 3ème / 8ème SSR 14 octobre 2015
conclusions de Mme CORTOT BOUCHER .pdf
considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que Mme A... avait appréhendé l'intégralité du prix de cession des actions et jugé que la conclusion d'une convention de quasi-usufruit, postérieurement à la cession et alors qu'une partie de ce prix, excédant la quote-part correspondant à la valeur de l'usufruit des actions, avait déjà été réglée à MmeA..., révélait que celle-ci n'avait pas eu l'intention de mettre ses enfants en possession de la nue-propriété soit de ces actions, soit d'autres titres démembrés, comme stipulé dans les actes de donation du 28 mars 2003, mais seulement de constituer à leur profit une simple créance de restitution, au demeurant non assortie d'une garantie ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve en raison de l'avis défavorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, démontrait que la donation de la nue propriété des actions aux enfants ne pouvait être regardée comme ayant été irrévocablement consentie et qu'en raison du caractère fictif de cette donation, celle-ci ne lui était pas opposable en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la cour n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'erreur de droit ni d'erreur dans la qualification des faits qui lui étaient soumis ;
Les faits étaient les suivants
a)par actes unilatéraux en date du 28 mars 2003, enregistrés le 19 juin 2003, Mme B...a déclaré faire donation, d’une part, à son fils majeur C...B...de la nue-propriété de 187 actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation et, d’autre part, à son fils mineur A...B...de la nue-propriété de 188 autres actions de la même société, tout en conservant, pour elle-même, l’usufruit de ces 375 actions ;
la valeur des actions respectivement démembrées et cédées à titre gratuit aux deux fils de Mme B...a été évaluée à 456 333 euros et 458 874 euros, soit au total, pour les deux donations, 915 327 euros, la valeur de la seule nue-propriété transmise, représentant 60 % de la valeur en pleine propriété, étant elle estimée, s’agissant des actions cédées à M. C...B..., à 273 860 euros et, s’agissant des actions cédées à M. A...B..., à 275 324 euros, soit au total, pour les deux donations, 549 185 euros ;
b)par acte daté du 31 août 2003, M. C...B..., M. A...B...et Mme B...ont respectivement cédé à titre onéreux à la SAS Ferneydis, pour un prix global de 1 915 000 euros, la nue-propriété de 187 titres, la nue-propriété de 188 titres et l’usufruit des 375 titres de la SAS Rhodanienne d’alimentation ;
la SAS Ferneydis a procédé au règlement du prix de cession par quatre chèques ou virement tous versés au nom de Mme B..
c) par acte daté du 29 septembre 2003, Mme B.. et ses fils A...et C.. ont convenu de convertir l’usufruit des actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation en un quasi-usufruit au sens de l’article 587 du code civil portant sur ces actions ou sur leur prix de cession en cas de vente ultérieure de celles-ci ;
les avantages et les inconvénients du quasi usufruit
Position de l’administration
dans la proposition de rectification adressée à Mme B...le 31 mai 2007, le vérificateur a considéré qu’en raison de l’absence d’acceptation par les donataires des donations, de l’absence de perception de droits de mutation lors de ces donations, de la communauté d’intérêts existant avec l’acquéreur, du règlement à Mme B... de l’intégralité du prix de cession, et de la signature, postérieurement à la cession, d’une convention de quasi-usufruit non assortie de garantie, il n’existait aucune réelle intention libérale de la part de Mme B..., qui s’est dans les faits réappropriée l’intégralité du prix de cession, et que, dès lors, les actes de donation procédant au démembrement des titres litigieux étaient constitutifs d’un montage artificiel ayant pour seul but de minorer le montant de la plus-value de cession réalisée lors de la vente des actions ; qu’il en a conclu que ces actes, entachés d’abus de droit, ne pouvaient être opposés à l’administration et que, par suite, il y avait lieu de regarder Mme B...comme ayant cédé elle-même la pleine propriété des titres et comme étant soumise, sur la totalité de leur prix de cession, à l’imposition, dans les conditions prévues aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, de la plus-value réalisée ;
après un avis du 9 juin 2008 défavorable pour l administration rendu par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, page 16 du rapport pour 2008 cliquer le montant de ses cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2003
La CAA DE LYON confirme
l’administration et le tribunal de Lyon
en relevant, au cours de la procédure de rectification, que Mme B...s’est réappropriée l’intégralité du prix de cession, fût-ce sous couvert d’une convention de quasi-usufruit, l’administration fiscale a établi que les actes de donation n’ont pas été motivés par l’intention libérale affichée et que ces actes, en tant qu’ils dissimulent la véritable nature de la chose donnée, présentent un caractère fictif ; que, dans cette mesure et pour ces seuls motifs, le ministre de l’économie et des finances apporte la preuve que Mme B...a commis un abus de droit ;
13. dès lors, il y a lieu de restituer leur véritable caractère aux opérations litigieuses ; que, compte tenu de l’abus de droit commis par MmeB..., celles-ci doivent être analysées comme des cessions simultanées de la nue-propriété et de l’usufruit de parts sociales démembrées, pour lesquelles le report de l’usufruit sur le prix était prévu dès l’acte qui est à l’origine du démembrement de propriété ; il résulte que, dans une telle hypothèse, la plus-value devait être intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le montant de la plus-value réalisée par Mme B...devait être calculé en tenant compte de la totalité du prix de cession des actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation ;
10:33 | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
09 décembre 2025
CJIP SANTANDER POUR FRAUDE FISCALE (05/12/2025
patrickmichaud@orange.fr
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
 Une enquete a été ouverte en février 2011 par la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée) de Paris, après réception d’une plainte de la société BANCO SANTANDER dénonçant des faits commis au sein d’une de ses agences à Paris.
Une enquete a été ouverte en février 2011 par la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée) de Paris, après réception d’une plainte de la société BANCO SANTANDER dénonçant des faits commis au sein d’une de ses agences à Paris.
Les investigations, confiées à la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF) de la police judiciaire de Paris, ont permis d’établir l'existence d'un système illicite de compensation caractérisé notamment par l’encaissement de chèques établis au nom de personne morales sur les comptes bancaire de certains clients personnes physiques de BANCO SANTANDER et la fourniture de numéraire à des clients en dehors de tout circuit bancaire, pour un montant total de flux créditeurs constatés sur les comptes bancaires litigieux d’environ 49 millions d’euros au cours des années 2003 et 2010.
Une information judiciaire a été ouverte en mai 2013 des chefs de blanchiment aggravé de divers délits notamment de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux, de banqueroute et d’escroquerie en bande organisée, de démarchage bancaire ou financier illicite et d’exercice illégal de la profession de banquier ainsi que des chefs de complicité et recel de ces délits.
Le 5 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue le 2 décembre 2025 entre la procureure de la République de Paris et la société BANCO SANTANDER, en application des articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale
- Convention judiciaire d’intérêt public - Société BANCO SANTANDER
Aux termes de la CJIP, la société BANCO SANTANDER s'engage à verser au Trésor public 22 500 000 euros d'amende d'intérêt public. L’Etat, partie civile dans le cadre de l’information judiciaire, n’a pas fait valoir de demande indemnitaire au titre de cette CJIP.
L'exécution des obligations prévues par la CJIP entraînera l'extinction de l'action publique à l'égard de BANCO SANTANDER.
La décision de validation de la CJIP n'emporte pas déclaration de culpabilité
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL
;La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
17:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
07 décembre 2025
Echange de renseignement sur les immeubles OCDE 4 DECEMBRE 25
 La fin du secret des biens immobiliers détenus à l’étranger est enclenchée,
La fin du secret des biens immobiliers détenus à l’étranger est enclenchée,
L’administration fiscale connaîtra bientôt l’existence des biens immobiliers détenus à l’étranger, ainsi que les revenus qu’ils génèrent, même s’ils n’ont pas été déclarés. Tout comme les données sur les comptes bancaires s’échangent maintenant entre les États, les données sur les actifs non financiers comme l’immobilier vont suivre, suite à un accord qui vient d’être signé dans le cadre de l’OCDE.
Engagement collectif à échanger les renseignements déjà disponibles
sur les biens immobiliers
NOTE EFI sauf erreur, ka notion de SPI ne semble pas avoir ete definie?
La France a l'intention d'adopter l'AMAC RBI d'ici 2029 ou 2030, sous réserve de l'accomplissement des procédures nationales adéquates.
13:25 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
28 novembre 2025
Un holding Luxco de simple portage est il le bénéficiaire effectif ??(suite de CE 8/11/24 Conc de Mme Bokdam-Tognetti,)
La situation de fait prime
la situation de droit ??La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???
Le benefiaire effectif : de la propriete ?du pouvoir de decision ?du résultat ?du creancier final ?? ETC
Nous essayons d apporter certains éléments de réflexion et de décision
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ?
peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
MISE A JOUR NOVEMBRE 2025
En suivant la JP du CE de novembre 24 lire dessous
Par Alice de Massiac, Clara Maignan
Pour écarter la qualification de bénéficiaire effectif, la Cour se fonde (sans la nommer explicitement) sur l’absence de substance de la société luxembourgeoise en soulignant que :
Elle n’avait pas d’autre objet que la prise de participations dans des sociétés ;
Elle avait, au titre des années vérifiées, pour seuls produits, les dividendes provenant de ses filiales ;
Elle n’avait aucune activité économique autonome ;
Si la société française arguait que les dividendes versés à sa mère luxembourgeoise n’avaient ensuite fait l’objet d’aucun reversement à un tiers, elle ne l’établissait pas
A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques
de l’OCDE et du GAFI
Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE . de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
la jurisprudence du CE
Conseil d'État N° 4711479ème - 10ème chambres réunies 8 novembre 2024
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
La société Foncière Vélizy Rose SAS qui exerce une de tivité de location immobilière,,filiale à 100 % de la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015.
Par ailleurs l’arret de la CAA de Paris nous révèle que la société Vélizy Rose Investment qui détenait l'intégralité du capital social de la société requérante avait elle-même pour associé unique la société Dewnos Investment,luxco
Enfin la société Lux Vélizy Rose Investment ne disposait d'aucun moyen humain et matériel,elle n'avait pas d'autre activité que celle de porter les titres de la société Foncière Vélizy Rose SAS et que ses deux dirigeants étaient également ceux de son actionnaire unique, la société Dewnos Investment.
À l'issue de cette procédure, l'administration a notamment remis en cause l'exonération de la retenue à la source appliquée par la société sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts consécutivement au versement, au cours de l'année 2014, à la société Vélizy Rose Investment (VRI), société de droit luxembourgeois, d'une somme de 3 600 000 euros à titre d'avance sur des dividendes distribués.
L'administration a, par suite, mis à la charge de la société Foncière Vélizy Rose SAS une retenue à la source d'un montant de 1 542 857 euros en droits, assortie d'une majoration de 10 % en application de l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard correspondants. et, à titre subsidiaire, à la réduction de la retenue à la source par application du taux de 5 % prévu par l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
La cour administrative d’appel ayant confirmé la position du fisc, le redevable s’est pourvu devant le consiel d etat
CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/12/2022, 21PA05986
Le conseil confirme
Conseil d'État N° 4711479ème - 10ème chambres réunies 8 novembre 2024
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
.3) Une société établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui a reçu, de la part d’une société française dont elle détenait l’intégralité du capital social, un acompte sur dividendes qu’elle a, le lendemain, intégralement reversé à son associée unique, alors qu’elle ne disposait pas d’autres fonds disponibles, et qui n’a pas d’autre activité que celle de porter les titres de la société française ne peut être regardée comme la bénéficiaire effective de cet acompte sur dividendes, au sens et pour l’application de l’article 119 ter du CGI.
En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique.
16:36 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
22 novembre 2025
guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;d'abord la prévention
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
patrickmichaud@orangr.fr
06072659708
« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »
L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général
Pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Les obligations de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale
article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est complété par une nouvelle partie ainsi rédigée :
« Devoir de prudence
« 1.5.
« Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier. »
D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????
LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie
Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??
Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à NICE le 19 octobre 2018
L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique de cette présentation
La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général
L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général
Pour lire et imprimer avec les liens cliquez
L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2
L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2
L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2
L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2
L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3
Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3
Les obligations des banquiers et assimilés. 3
Les obligations des avocats. 4
La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4
Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4
Le droit de dissuader est reconnu. 4
Les procédures juridictionnelles. 4
Les consultations juridiques. 4
Sur la définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5
Pour déclarer l’avocat doit soit être mandataire soit assister à une transaction. 5
Le cas des conseils fiscaux. 5
Nos obligations pour prévenir: la décision du CNB du 30 juin 2011. 8
19:31 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, TRACFIN et GAFI | Tags : guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
21 novembre 2025
La Résidence Fiscale Internationale : Analyse des Critères Internes et Conventionnels

patrickmichaud@orange.fr tel 0607269708
La notion de résidence fiscale internationale permet de déterminer dans quel État une personne est considérée comme résidente à des fins fiscales, et donc soumise à une imposition mondiale ou restreinte. Cette qualification conditionne l’application des règles de territorialité, la lutte contre la double imposition, et l’application des conventions fiscales bilatérales.
Dans un contexte d’expatriation, de mobilité professionnelle et de patrimoines internationaux, la qualification du domicile fiscal revêt une importance majeure. En cas de double domiciliation apparente, les conventions fiscales – principalement inspirées du Modèle OCDE – viennent déterminer l’État de résidence unique.
L’article présente successivement les règles internes françaises, les critères conventionnels de départage issus de l’OCDE (voir :
et les commentaires :
puis analyse les principales jurisprudences pertinentes.
I Principe de supériorité et de subsidiarité des conventions fiscales
II Critères de résidence fiscale
A en droit interne
B Critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE)
III Double imposition et rôle des conventions fiscales
iv les regles etrangeres
I V. Conclusion
Encadré récapitulatif
Principe de supériorité et de subsidiarité des conventions fiscales
Conseil d'État° assemblée 232276 28 juin 2002
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer- en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale
Le Conseil d’État rappelle que la convention ne constitue jamais une base d’imposition autonome : il faut d’abord appliquer la loi interne (France), puis vérifier si la convention écarte cette imposition.
Décision fondamentale :
CE, Assemblée, 28 juin 2002, Schneider Electric, n°232276
Décision complémentaire :
CE 11 avril 2008, Cheynel, n°285583
Ces arrêts confirment la logique en deux temps :
La France est-elle compétente selon sa loi interne ?
II Le choix des critères de la residence fiscale
La residence fiscale est determinée par des criteres de droit interne et de droit conventionnel par les traites signés par la France
Liste des conventions fiscales signées par la France
Mais le choix du critere est determinee de maniere differnte
Au niveau du droit intene
Le choix des critères est libre c'est-à-dire que l administration peut choisir le critère le plus favorable tel que l articel 4B CGI les determine
Le Conseil d'Etat détermine la localisation d apres l’article 4 B CGI
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Au niveau du droit conventionnel
les criteres du droit conventionnel sont hierarchisés
en droit fiscal international la détermination de la residence est soumise à des critères hiérarchiques, c'est-à-dire qu’à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
- A Critères de résidence fiscale en droit interne
En droit français, les critères du domicile fiscal figurent à l’article 4 B du Code général des impôts :
Selon ce texte, une personne est résidente fiscale française dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
- les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
- celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles n'établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,
- les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
L'administration a le droit d 'utiliser le critere qui lui est le plus favorable
Le BOFiP commente longuement ces critères :
La jurisprudence illustre leur mise en œuvre.
Par exemple, un contribuable ayant séjourné 302 jours en France a été considéré comme résident (CE 5 juillet 1961, n°37182) :
Lorsque ces critères désignent la France, mais qu’un autre État revendique aussi la résidence, on applique alors les critère conventionnels.
- B Critères conventionnels de la résidence fiscale (Modèle OCDE)
Les conventions fiscales (bilatérales) s’inspirent du Modèle OCDE (Article 4).
La mise à jour 2025 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a)le premier critere le foyer d habitation permanente
cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
residence fiscale : séjour principal ou séjour habituel et la regle des 183 jours
( CE 16.07.20 avec conclusions Ciavaldini
- b) (A DEFAUT)le centre des interets vitaux
- si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- c) (A DEFAUT) le sejour habituel
- si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
Décisif si les intérêts vitaux sont indéterminables.
CE 16 juillet 2020, n°436570, donne une définition très claire :
Il ne s’agit pas seulement du seuil de 183 jours, mais du lieu où la personne séjourne habituellement et régulièrement.
- d) (A DEFAUT) la nationalite
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
- e) (A DEFAUT) l 'accord entre administrations
- si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères non hierarchusés, l’administration pouvant utiliser le critère approprie,
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
IV Les regles etrangeres
|
Royaume-Uni |
Application du Statutory Residence Test depuis 2013 : présence physique ≥183 jours au Royaume-Uni sur l’année fiscale en cause ⇒ résident britannique d’office (uklandlordtax.co.uk). En deçà de 183 jours, d’autres conditions interviennent : par exemple, avoir une maison disponible au Royaume-Uni sur au moins 90 jours et y passer au moins 30 jours (uklandlordtax.co.uk), ou travailler à plein temps au Royaume-Uni sur une période d’au moins un an (uklandlordtax.co.uk). À l’inverse, une personne ayant été résidente UK les années précédentes sera considérée non-résidente si elle y passe moins de 16 jours l’année en question (46 jours si non-résident les 3 années précédentes) (uklandlordtax.co.uk). Le Royaume-Uni utilise également des « liens suffisants » (famille, logement, travail, etc.) : moins on passe de jours au UK, plus il faut de liens forts pour être résident, et vice-versa. |
|
États-Unis |
Système fondé sur la citoyenneté et la présence. Un citoyen américain (y compris binational) ou un détenteur de Green Card est toujours considéré comme résident fiscal américain, imposable sur ses revenus mondiaux. Un étranger non résident peut devenir résident fiscal s’il remplit le substantial presence test : présence physique aux États-Unis d’au moins 31 jours dans l’année en cours et 183 jours au total sur l’année en cours et les deux années précédentes (calcul pondéré) (santoslloydlaw.comsantoslloydlaw.com). Par exemple, 120 jours par an pendant 3 ans consécutifs suffisent à franchir le seuil. Des exceptions existent (étudiants, diplomates de passage, etc.), mais le principe général est qu’aux USA la résidence fiscale s’acquiert par la présence prolongée ou le statut de résident permanent. À noter, les États-Unis imposent leurs citoyens même s’ils vivent à l’étranger, ce qui est une singularité du système américain. |
|
Suisse |
La résidence fiscale suisse repose sur la notion de domicile ou de séjour prolongé. Une personne est considérée comme résidente fiscale si elle s’établit en Suisse avec l’intention d’y demeurer durablement (domicile au sens du Code civil), ou si elle séjourne en Suisse plus de 30 jours consécutifs avec une activité lucrative (travail), ou plus de 90 jours sans exercer d’activité (bergeotpaoli.com). Ainsi, un salarié détaché en Suisse pour plusieurs mois y acquiert une résidence fiscale. En cas de conflit de résidence avec un autre pays (notamment pour les frontaliers ou expatriés), la convention fiscale franco-suisse prévoit les critères de départage habituels (foyer permanent, intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité) (bergeotpaoli.com). La Suisse, à l’instar d’autres pays, utilise le critère temporel (90 jours) inférieur au seuil de 183 jours, reflétant sa volonté d’attirer des résidents tout en évitant les situations d’évasion fiscale. |
Remarque : D’autres juridictions peuvent avoir leurs propres spécificités. Par exemple, la Belgique retient principalement le domicile fiscal au sens du lieu du foyer familial, combiné à un critère de séjour de plus de 6 mois. Luxembourg et Monaco accordent une grande importance à l’inscription administrative ou au domicile officiel. Chine ou Russie utilisent également le critère des 183 jours annuels avec des aménagements. L’objectif commun reste d’identifier le centre de gravité des intérêts d’une personne pour l’assujettir à l’impôt de manière juste.
Conclusion
La résidence fiscale internationale se situe au croisement du droit interne et du droit conventionnel.
En droit français, les critères du domicile fiscal sont alternatifs ; en droit conventionnel, les critères du Modèle OCDE sont strictement hiérarchisés.
La jurisprudence (Tedesco, Schneider Electric, Curot…) donne des clés essentielles pour l’interprétation de ces règles.
Au-delà d’une simple qualification administrative, la résidence fiscale conditionne :
l’imposition mondiale,
la prévention de la double imposition,
la mobilité internationale,
des enjeux successoraux importants.
La compréhension de ces critères est indispensable pour tout contribuable ou professionnel confronté à des situations transfrontalières.
Encadré récapitulatif – Critères OCDE (liens en brut)
Foyer d’habitation permanent
Centre des intérêts vitaux
Séjour habituel
Nationalité
Procédure amiable
18:14 | Tags : la résidence fiscale internationale : | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
L’EXIT TAX : Sursis d 'imposition des plus values en cas de depart à l etranger ? vers un durcissement
 patrickmichaud@orange.fr
patrickmichaud@orange.fr
A fin de ne pas inciter les résidents de transférer leur domicile a l étranger pour échapper à l imposition des plus values mobilières , Le legislateur a prevu que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, conformément à l’article 167 bis du code général des impôts tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition.
Un résident fiscal français depuis toujours, est dirigeant d’entreprise et souhaite résider quelques années à l etranger pour développer son entreprise. Il envisage de céder ses actions (valorisées 3 M€) à terme. Il s’interroge sur le sort de la fiscalité de ses différents revenus et de la plus-value latente.
ATTENTION LE PLF26 POURRAIT DURCIR LES CONDITIONS ACTUELLES
LA FRANCE ET L’EXIT TAX : UNE RELATION DOULOUREUSE
La derniere jurisprudence
Conseil d'État N 476399 9ème - 10ème chambres réunies 5 fevrier 2025
il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que l'imposition des plus-values latentes et en report d'imposition sur le fondement des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts doit être regardée comme régie par le droit de l'Union.
Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique au motif que, dès lors que les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts n'étaient pas contraires à la liberté d'établissement, les impositions en litige étaient uniquement régies par la loi française et non par le droit de l'Union européenne, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif fiscal dit d’ « Exit Tax » qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France.
L’administration fiscale peut taxer les plus-values latentes des contribuables français qui transfèrent leur domicile fiscal à l’étranger comme si leurs titres étaient vendus le jour de leur départ, lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies :
-Avoir été résidents fiscaux français pendant au moins six ans au cours des dix années précédant leur départ ; et
-Détenir des titres de sociétés atteignant une valeur globale d’au moins 800.000 euros ou représentant au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société
Formulaire 2074-ETD : Déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal intervenu
Notice(s)
Notice 2074-ETD-NOT : Ntice de la déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal
Le formulaire de suivi
Formulaire 2074-ETS3 : Déclaration de suivi "Exit tax" (suivi 2022)
Notice(s)
Notice 2074-ETS3-NOT : notice de la déclaration de suivi "Exit tax" Ko
Ce dispositif vise à taxer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées, à la date du changement de domicile des personnes physiques.
Le taux d’imposition est celui en vigueur à la date du transfert.
LE CONTRIBUABLE CONCERNÉ PAR L'EXIT TAX ?
Les contribuables résidents fiscaux français établissant au cours d’une année leur résidence dans un nouvel État, dès lors que :
-Ils ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile à l’étranger ;
-Et, ils possèdent des droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou excédant en valeur globale 800 000 €.
LES ACTIFS VISÉS PAR L'EXIT TAX ?
Sont concernées par l’Exit Tax l’ensemble des plus-values portant sur :
Les actions et les parts sociales (y compris les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)) ;
Les OPCVM (SICAV et FCP) ;
Les obligations et autres titres d’emprunt négociables ;
Les droits détenus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété ;
Certaines plus-values déjà placées en report, à la date du départ de France dont notamment les plus-values d’apport à une société (CGI art. 150-0 B bis et 150-0 B ter), y compris les créances de complément de prix.
LES ACTIFS EXCLUS
- Les actions détenues sur un PEA ;
- Les BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) ;
- Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation ;
- Les parts de société à prépondérance immobilière soumises à l’IR ;
- Les biens immobiliers.
QUEL RÉGIME D'IMPOSITION ?
Par principe, la plus-value est déterminée par la différence entre la valeur des titres, à la date du départ de France, et le prix d’acquisition des titres. Il s’agit bien d’une plus-value latente.
Le taux et les règles d’imposition sont celles en vigueur à la date du transfert de résidence, soit actuellement par défaut le dispositif du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).
QUELLE DATE DE PAIEMENT ?
Le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement :
SURSIS AUTOMATIQUE
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans :
- un pays de l’UE ;
- ou un pays hors UE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
SURSIS OPTIONNEL
En l’absence de sursis automatique, le contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un autre pays peut faire une demande expresse de sursis, sous réserve de déclarer les plus-values et créances imposables, de désigner un représentant fiscal en France et de constituer des garanties auprès du Trésor Public.
Cette demande doit être réalisée auprès du service des particuliers non-résidents dans les 90 jours qui précèdent le transfert de son domicile fiscal de France.
En l’absence de cession effective, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente fait l’objet d’un dégrèvement ou d’une restitution (à défaut de sursis), au terme d’un délai de :
- 2 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de « l’exit tax » est inférieure à 2,57 millions d’euros,
- et 5 ans au-delà.
Le délai est de 5 ans pour les prélèvements sociaux.
SOLUTION
Notre entrepreneur, résident fiscal français depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années, détient des actions de son entreprise en pleine propriété pour une valeur supérieure à 800 000 €. Il ne sera plus résident fiscal français dans 4 mois car il part s’installer à l etranger pour vivre et travailler.
Il sera donc soumis à l’Exit Tax.
La fiscalité afférente à ses plus-values latente sera calculée à la date de son départ de France, selon le taux et les règles d’imposition en vigueur. L’impôt de plus-value bénéficiera automatiquement d’un sursis de paiement, car il part s’installer dans un pays de l’Union Européenne jusqu’à la cession effective des titres si elle survient dans les 2 ou 5 ans (selon le montant de la plus-value).
08:44 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France | Tags : l’exit tax : sursis d 'imposition des plus values en cas de dep | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
17 novembre 2025
Prescription de l action en recouvrement ( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant en principal de 1 298 282 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003, qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2005.
Il a contesté ces impositions, avec une demande de sursis de paiement, par une réclamation enregistrée le 2 janvier 2006, puis une requête rejetée par le Tribunal administratif de Lille le 6 décembre 2007. L'administration a ensuite émis trois avis à tiers détenteur. L'administration a ensuite signifié à M. B..., par un huissier de finances publiques, trois mises en demeure de payer datées du 25 avril 2012.
Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que chacun de ces actes émis par l'administration a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de M. B... jusqu'au 25 avril 2016.
Le 24 novembre 2016, le tresor public lui envoie une mise en demeure pour payer les impots dus sur 2001 et 2003*
B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes , le TA rejette cette demande mais la cour d’appel de versailles admet la demande du contribuable ce qui est confirmé par le conseil d etat
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/12/2019, 18VE02436,
Conseil d'État N° 438333 31 MARS 2021
8ème - 3ème chambres réunies
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Sur la competence du juge administratif 1
sur le delai de prescription de l action en recouvrement 4 annees de date a date. 2
bofip - prescription de l'action en recouvrement 2
un acte envoye a une mauvaise adresse n’est pas interruptif 2
LIRE LA SUITE DESSOUS
14:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
10 novembre 2025
Pas de traite pour une holding luxembourgeoise sans siege effectif au luxembourg CAA PARIS 6 novembre 2025, 24PA00725

patrickmichaud@orange.fr 0607269708
La CAA de PARIS vient de refuser à une holding du Luxembourg l application du traite fiscal avec la France , celui de 58, sur le motif que le siege au Luxembourg était uniquement formel
CAA Paris, 6 novembre 2025, 24PA00725
Cette decision complete la jurisprudence sur la définition du siege effectif au sens des traites
Commentaires OCDE sur la residence fiscale
(lire §21 pour les personnes morales)
le siege social n’est pas de droit
le lieu de direction effective
ce 15 mars 23 conc domingo
Nous rappelons que la CAA de Nantes (7 octobre 2025 - a jugé que l’exigence française de “siège de direction effective” n’était pas conforme aux conditions fixées par la directive 2011/96/UE, laquelle ne retient que l’obligation d’une domiciliation fiscale dans un État membre.
Comment va statuer le conseil d etat et dans quelle formation ???
La situation jugee par la CAA de Paris
La société Transart International, qui exerce une activité de transport international et de stockage sécurisé d'œuvres avait distribué en 2014 et 2015 d’importants dividendes à sa société mère luxembourgeoise.
Elle revendiquait à titre principal l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter CGI (régime mère-fille européen) et, à titre subsidiaire, le taux réduit de 5 % prévu par l’ancienne convention fiscale franco-luxembourgeoise (régime mère-fille conventionnel).
Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a refuse l application de l article 5 du traite fiscal avec le Luxembourg –celui de 58-et a estimé que des dividendes distribués à son unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Infinity Art Logistic, au cours des années 2014 et 2015 devaient faire l'objet d'une retenue à la source au taux de 30 % en application de l'article 119 bis du code général des impôts.
La situation de fait
la société luxembourgeois Infinity Art Logistic, qui est immatriculée au Luxembourg et exerce une activité de prise de participations,
-n'est locataire que d'un simple bureau dans les locaux d'une société de domiciliation,
- n'emploie aucun salarié et
-n'a supporté, hormis les honoraires ayant trait à sa domiciliation à la tenue d'une comptabilité selon les règles applicables au Luxembourg et à sa surveillance par un commissaire aux comptes ainsi que le paiement d'une taxe communale due en raison de sa qualité de locataire du bureau qui vient d'être évoqué, aucune charge de fonctionnement au cours des années d'imposition en litige.
Par ailleurs, il est constant que deux des administrateurs de cette société sont des avocats d'affaires qui sont également administrateurs d'autres sociétés et que l'unique actionnaire de la société requérante réside à Singapour.
Pournla CAA, même si les CA et AG se sont tenus au Luxembourg, le siège de direction effective ne pouvait y être situé.
Dans ces conditions, si les conseils d'administration et les assemblées générales de cette société se sont tenus, au cours des années en litige, au Luxembourg, son centre de direction effective ne peut être regardé comme étant situé dans cet Etat au sens des dispositions précitées de l'article 119 ter du code général des impôts.
Ce motif étant à lui seul de nature à fonder l'application de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les autres moyens invoqués par la requérante, tirés de ce que la société Infinity Art Logistic est le bénéficiaire effectif des dividendes et de ce que l'administration aurait fait à tort application du dispositif anti-abus prévu par le 3 de l'article 119 ter du code général des impôts doivent être écartés.
19:44 | Tags : avocat fiscalsite international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
09 novembre 2025
LES secrets professionnels de l’avocat face aux droits de communication fiscaux
 Ce que j'ai appris dans le secret de la confession,
Ce que j'ai appris dans le secret de la confession,
je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris"
(Saint Augustin).
20 AOUT 1610
Le confesseur sera il obligé à la déclaration de soupçon ? Voltaire
Le secret professionnel de l avocat est une obligation de l avocat sanctionnée pénalement et dont la violation par les administrations fiscales peut entrainer la nullité totale ou partielle des redressements.
Toutefois d’une part le secret n’est pas « un fond de commerce professionnel » comme l a rappelé Mme C LAGARDE devant le sénat et d’autre part un certain nombre d’exceptions en limite la portée"
Contenu et limites du secret professionnel
Par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu,
Dans le cadre de sa stratégie de recherche des preuves de fraude fiscale, la DGFIP dispose de nombreux outils , notamment de ses droits de communication :par exemple le droit de communication sur demande ou des droits de communication avec saisie soit dans le cadre soit de la procédure de visite domiciliaire civile ( article L 16 B CGI) soit des procédures pénales fiscales sur enquête préliminaire de fraude fiscale diligentée par le procureur de la république ou sur commission rogatoire diligentée par un juge d’instruction ou encore sur enquête douanière
La question se pose fréquemment de connaitre les limites du principe du secret professionnel de l avocat avec le droit du recherche de la preuve d’une infraction
Deux catégories de secret peuvent être opposées à ces demandes de communications. 1
A Le secret professionnel stricto sensu de l avocat 1
B Le secret en matière de facturation (art L13-0 A du LPF. 2
Deux catégories de secret peuvent être opposées
à ces demandes de communications
A Le secret professionnel stricto sensu de l avocat
le secret professionnel –qui vise tant l’ activité judicaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par L’article 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé
A ce jour, le secret professionnel de l’avocat est une norme juridique consacrée en droit européen par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et la cour européenne de l’union européenne
Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en novembre 2019)
Il est illimité dans le temps et dans l’espace. Le client ne peut pas en délier l’avocat.
Le secret n’est pas un droit ni un privilège mais un devoir pour le professionnel avocat : c’est le corolaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir se confier à un confident nécessaire qui ne la trahira pas.
Le secret de l avocat n’est
Ni le secret défense prévu par l article 413-9 du code pénal et dont la violation est punie par les très lourdes sanctions des articles 413-10 et suivants du code pénal
-Ni, bien sur un fond de commerce comme Mme C LAGARDE en avait « parlé » devant le sénat en aout 2008
le secret de l avocat est il un fonds de commerce
(Me C Lagarde 5 juillet 2008 au Sénat)
la justice n est pas une marchandise par le bâtonnier JM BURGUBURU
B Le secret en matière de facturation (art L13-0 A du LPF
Cet article dispose que » les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
Toutefois le texte ne prévoit pas de disposition concernant l’identité du bénéficiaire effectif de la prestation. Dans ce cadre, la CAA de PARIS du 12 octobre 2017 (arrêt public mais publié uniquement par EFI !!!) sur renvoi du CE (04.05.2016 avec conclusions libres de Mme de BRETONNEAU a annulé un redressement TVA concernant une facture payée par un trust des Bermudes à un avocat sur le fondement du secret professionnel de l’avocat.
Il n’apparait pas que l’administration se soit pourvue en cassation contre cette arrêt très particulier et qui sera très utilisé avec le royaume uni à compter du 1er janvier 2020
TVA et trust hors UE : qui est le bénéficiaire : le trustee ou le bénéficiaire Economique
CE 4 MAI 2016 avec conclusions LIBRES de MME de Bretonneau
Enfin, certains –mais pas tous- estiment que la Tva communautaire semble être devenue « un filet à maille large d’évasion fiscale » contraire d’une part à une saine concurrence et d’autre part aux finances publiques de nos « tax payers » de l’union
LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat
Note efi Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la législation fiscale à la DGFIP
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
Un certain nombre, mais pas tous, aimerait ainsi élargir ce droit de communication à l’ identité du bénéficiaire effectif , dont il sera nécessaire d’unifier les définitions , et notamment pour prévenir une évasion TVA qui semble se préparer dès la mise ne application du Brexit au détriment d’une part des budgets de chacun des états membres et aussi en faussant la concurrence entre prestataires de services dans et hors union comme l’avait déjà précisé l’IACF devant la commission des finances le 18 mai 2016
Apres le BREXIT, la TVA dite européenne va-t-elle devenir une arme économique anticoncurrentielle
Depuis un certain nombre de mois, des cabinets britanniques, encore installés dans l UE, conseillent à leurs clients de rédiger des clauses de compétence en faveur des tribunaux britanniques et d’application ce la common law
Les objectifs non dits sont notamment de facturer de Londres sans TVA leurs clients communautaires, assujettis ou non …
17:25 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
30 octobre 2025
L’enquête sous pseudonyme à des fins de lutte contre la fraude fiscale
 Internet ! un moyen de délecter les fraudes ?
Internet ! un moyen de délecter les fraudes ?
La loi de finances pour 2024 a créé à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales une procédure d’enquête sous pseudonyme.
Les agents des finances publiques spécialement habilités disposent ainsi de la possibilité de mener une enquête fiscale en ligne sous pseudonyme.
Notamment
2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale la direction nationale d'enquêtes fiscales., ces agents peuvent participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ;
Le champ d’application de cette procédure est limité à certains manquements fiscaux particulièrement graves : activité occulte, manquement délibéré, abus de droit, manoeuvre frauduleuse, absence de déclaration d’un compte bancaire à l’étranger, d’un contrat de capitalisation ou d’un trust, revenus non déclarés provenant d’une activité illégale.
Les agents des finances publiques spécialement habilités usant de ce dispositif sont ainsi exonérés de responsabilité pénale au titre des actions menées dans ce cadre.
L’enquête peut être passive ou active mais ne peut pas inciter le contribuable à commettre un manquement.
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE
ART Art. 1744. – I.CGI BOFIP 28-08-24
13:41 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
28 octobre 2025
Prélèvements obligatoires confiscatoires ; 10 décisions du conseil constitutionnel - et la théorie du ruissellement

Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
- « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »
Histoire de l'impôt en France
Les débats sur des augmentations fiscales et sociales vont prochainement reprendre
Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres ) est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou administratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales
En 2024, les dépenses publiques en France se sont élevées à 1 670 milliards d'euros, soit 57,1% du PIB, selon Fipeco. Cela représente une augmentation par rapport à 2023, où les dépenses étaient de 1 607 milliards d'euros (56,9% du PIB).
la répartition des PO par catégories d’administrations publiques :
en % du total des PO )
--Administrations de sécurité sociale (ASSO). 55%
--Etat : 28 ,4 %
--Administrations publiques locales (APUL) 14,5%
--Organismes divers d’administration centrale (ODAC), 1,5%
--Institutions européennes t 0,6 %
théorie du ruissellement,
« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement » Par Laurent Telo journaliste
selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,
La question que nous sommes nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete les effets budgétaires et économiques de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO ???
le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP (derniere etude 2017??°
Les incitations à travailler davantage pour les personnes en emploi en France en 2014 sont mesurées par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP)
par Juliette Fourcot, Laurence Rioux et Michaël Sicsic, division Études sociales, Insee
80 % des personnes ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014 (INSEE)
La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs.
le rapport 2023 sur les 100MM € de dépenses fiscales (cour des comptes)
Les dépenses fiscales de 2017 à 2022
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Comme l’a souligné A. Laffer, il existe pour chaque impôt un taux maximal du point de vue budgétaire. En effet, un taux nul ne rapporte rien et un taux de 100 % ne rapporte rien non plus, la matière imposable disparaissant. Mathématiquement, il existe donc un taux d’imposition compris entre 0 et 100 % au-delà duquel les recettes fiscales diminuent lorsque le taux d’imposition augmente. .
Pae ailleurs, il est necessaire d'analyser l assiette du prelevement : a titre d’exemple le taux des droits de succession est eleve MAIS son assiette inclus aussi l'imposition des plus values latentes des biens transmis comme le rappel le rapport de l OCDE de 2021 qui propose une modification
MAIS QUEL TAUX ET AVEC QUELLE ASSIETTE
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
LES PISTES PUBLIQUES DE REFLEXION
SUR UNE MODIFICATION DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Reforme fiscale : des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Traquer la fraude sociale au lieu d’augmenter les impôts par Charles PRATS, magistrat
Avec la 1ere recommandation de TRACFIN du 10 décembre 2020
Étendre l’exercice des contrôles a priori dès le versement et la gestion courante
des prestations sociales
la position du conseil d etat
la position de la cour de cassatioon
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021)
LE PLAN DE LA TRIBUNE
la tribune en htlm non mise a jour
la tribune en pdf avec liens non mise a jour
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire 2
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire 2
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt 3
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires 3
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel 4
Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnelles 4
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau » 4
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 4
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions 5
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières 5
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6
Des dispositions fiscales "confiscatoires" jugées constitutionnelles 7
-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire. 7
-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire 7
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7
-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle
(qpc 28.06.19 avec conclusions LIBRES d’E Victor devant le CE.. 7
-10) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8
Égalité devant les charges publiques.doc
16:03 | Tags : prélèvements obligatoires confiscatoires | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |