24 février 2026
Lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres plf 2026

patrickmichaud@orange.fr
avocat fiscaliste international paris
Le rapport annexé au PLF 2026 sur la Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales nous informe sur les resultats des controles en fiscalite internationale
rapport annexe au PLF 2026
Cette annexe au projet de loi de finances 2025 analyse les politiques de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (fiscale, sociale, douanière), déjà présentées par le ministre chargé des Comptes publics en mai 2023 et comportant 35 mesures et la création du conseil d’évaluation des fraudes (CEF), renforce l’arsenal dont dispose l’administration fiscale pour lutter contre la fraude fiscale, tout en prolongeant les dispositifs visant à prévenir les situations d’irrégularités pour les contribuables de bonne foi.La DGFiP est ainsi l’une des administrations les plus impliquées dans la mise en œuvre de ce plan.
Resultats globaux du controle fiscal
l analyse sur la fraude internationale du rapport
L'autorité de la chose jugée ? uniquement pour la periode verifiee ou pour le montage en cause ??
Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée après la période vérifiée?
EN CE QUI CONCERNE LA FRAUDE A LA TVA INTERNATIONALE
( Intra UE ou Extra UE) ,
je n ai pas trouver de chiffres visant ce type de fraude
ci dessous deux exemples
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz
TVA et prestataires non UE ; va t on supprimer leur exoneration ??? Les jurisprudences CJUE ,CE et PENALE
EN CE QUI CONCERNE LA FRAUDE a L IS
I Le Contrôle des prix de transfert
LE Contrôle des prix de transfert reste un axe majeur de lutte contre la planification fiscale agressive Dans de nombreux cas, ces opérations, présentées comme légales, visent à soustraire délibérément la base imposable en France par l’utilisation de dispositifs complexes permettant de larges transferts de bénéfices vers des entités étrangères du même groupe, où ils seront peu, voire pas du tout, imposés.
Afin de lutter contre ces pratiques, l’article 57 du CGI demeure le dispositif le plus pertinent, et par conséquent le plus utilisé dans le cadre du contrôle de ces transactions.
En 2024, ce dispositif a été utilisé à 375 reprises (contre 347 en 2023) pour un total de 3,375 Mds€ en base contre 2,34 Mds€ en 2023, soit une augmentation de 44 % des montants rehaussés.
II LE CONTROLE DE LA TERRITORIALITE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L’article 209-I du CGI détermine les règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés. C’est sur ce fondement que sont imposés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et dans le respect des conventions fiscales, les entreprises étrangères qui disposent sur le territoire français d’un Siège de Direction Effective (SDE) ou d’un établissement stable (ES).
En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 183 reprises (126 fois en 2023) pour un montant total de rectifications, en très forte augmentation, de 1,57 Mds€ en base (453 M€ en 2023).
III La lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable
- A L’article 123 bis du CGI
Ce dispositif permet d’imposer une personne physique domiciliée en France à raison de bénéfices réalisés par une entité établie dans une juridiction à régime fiscal privilégié dont elle détient plus de 10 % des droits et dont l’actif est principalement financier. Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.
En 2024, 52 dossiers ont donné lieu à des rectifications à hauteur de 37,5 M€ en base (136 M€ en 2023 pour 82 dossiers).
Les principaux États concernés sont : le Panama, les Îles Vierges Britanniques, Hong-Kong, les Bahamas, le Royaume-Uni, les Îles marshall et au sein de l’UE, le Luxembourg et la Belgique.
Compte tenu de la volonté manifeste des contribuables d’éluder l’impôt au moyen de structures interposées visant à dissimuler les véritables bénéficiaires des avoirs, ces dossiers font systématiquement l’objet de pénalités exclusives de la bonne foi, voire dans certains cas, de poursuites pénales, sauf régularisation spontanée, le cas échéant.
- B L’article 155 A du CGI
L’article 155 A du CGI permet d’imposer les revenus perçus par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de prestations rendues par une personne domiciliée ou établie en France lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite : la personne domiciliée en France contrôle la personne qui reçoit la rémunération ; la personne domiciliée en France n’établit pas qu’elle exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; la personne qui reçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Les rectifications peuvent concerner des activités diverses artistiques, d’agent de joueur, négociant immobilier, etc. et des sociétés interposées situées dans différents États (Luxembourg, Gibraltar, Belgique, Maroc, Espagne, Lettonie, etc.)
En 2024, ce dispositif a généré des rectifications de 14,7 M€ en base pour 33 dossiers (contre 16 M€ en 2023 pour 28 dossiers)
- C L’article 209 B du CGI
Ce dispositif vise à lutter contre la délocalisation de capitaux dans des États et territoires à régime fiscal privilégié et permet de rapatrier en France les bénéfices qui y sont réalisés par des entités contrôlées par des entreprises françaises. Au sein de l’Union européenne, il n’est applicable qu’aux montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Hors Union européenne, ce dispositif ne s’applique pas si la personne morale établie en France démontre que les opérations conduites par l’entité étrangère n’ont pas pour but principal de localiser des bénéfices dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entité établie à l’étranger exerce une activité industrielle ou commerciale effective sur son territoire1.
En 2024, ce dispositif a été appliqué à 4 reprises pour un montant de rectifications de 48 M€ en base (contre 528 M€ en 2023 pour 6 dossiers)
1 Cette clause de sauvegarde peut être combattue par la démonstration de la fictivité de l’activité établie à l’étranger : sociétés holding sans activité opérationnelle situées aux Îles Caïmans, sociétés d’un groupe constituant une coentreprise à Singapour sans y affecter de personnel
- D L’article 212 du CGI
L’article 212 du CGI vise à encadrer les charges financières en cas de faible imposition ou d’exonération des intérêts dans le résultat de l’entreprise liée créancière. Il permet ainsi de limiter la déductibilité des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement : taux d’intérêt excessif (article 212-I-a), absence d’imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b), sous-capitalisation (article 212-II).
En 2024, ce dispositif a été mis en oeuvre à 57 reprises (31 reprises en 2023) pour un montant total de rectifications de 114,7 M€ en base (521 M€ en 2023).
- E Le dispositif de l’article 238 A du CGI
Cet article vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieurs de 40 % à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France. Il prévoit que les sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans un pays à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif par les entreprises établies en France ne sont pas déductibles sauf si ces dernières apportent la preuve de la réalité des opérations et du caractère non exagéré de la dépense correspondante.
En 2024, ce dispositif a été appliqué à 16 reprises pour un montant de rectifications de 39,7 M€ en base (29 reprises et 37 M€ en 2023)
Les territoires concernés par l’application de l’article 238 A du CGI sont notamment Andorre, Chypre, l’Irlande, le Luxembourg, la Tunisie.
Resultats globaux du controle fiscal
Les résultats du contrôle fiscal 2024(page 73)
En 2024, les résultats financiers du contrôle fiscal (hors crédits d’impôts et taxes non remboursés) sont en augmentation de près de 1,5 Md€ (+9,78 %) par rapport à ceux de 2023 (soit 16,7 Md€ en 2024 contre 15,2 Md€ en 2023). En outre, le montant des crédits d’impôt et taxes non remboursés s’élèvent à 3,4 Md€ contre 3,3 Md€ en 2023 (+2,5 %) Hors crise sanitaire, ce haut niveau traduit pour partie les effets des mesures mises en place suite au plan fraude de 2018 et au plan de lutte contre toutes les fraudes de 2023.
Vérification sur place
I Vérification de comptabilité 2024
Nbre 37858 droit simple appelé (IR et IS) 6 863
II Examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP) :
Nbr 1835 droit simple rappéle 305
Contrôle sur pieces
Impot sur les societes Nbr 131018 droits simples 1187
Impot sur le revenu Nbr 361 086 droits simples 1283
TCA Nbr 24532 droits simples 379
18:21 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
22 février 2026
TAXE SUR LES ACFIFS NON OPERATIONNELLES DES HOLDINGS PATRIMONIALES
TAXE SUR LES ACFIFS NON OPERATIONNELLES DES HOLDINGS PATRIMONIALES
Une nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales a été instaurée pour lutter contre l'optimisation fiscale jugée agressive.Cette taxe au taux de 20% vise les actionnaires majoritaires ou les dirigeants de certaines sociétés francises ou etrangeres dont l'actif brut au 31 decembre dépasse 5 millions d'euros et qui sont détenues à plus de 50 % par des personnes physiques.
L’assiette de cette taxe est la valeur venale de certains actifs patrimoniaux
Le nouvel article 235 ter C du Code général des impôts (CGI) (art 7 ldf 26)instaure une taxe annuelle de 20 % dite « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
La nouvelle « taxe holding » sur les actifs somptuaires détenus par les sociétés patrimoniales.
Par Eve d’Onorio di Méo, Avocat
14:07 | Tags : taxe sur les acfifs non operationnelles des holdings patrimonial | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
19 février 2026
La déduction en cascade : une opportunité souvent oubliée !!
 patrickmichaud@orange.fr 0607269708
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Le système dit de la déduction en cascade permet de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés, à l'égard des droits simples, s'ils n'avaient commis aucune infraction.
L'article L. 77 du LPF[i] permet en effet aux contribuables d'obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés, l'imputation s'effectuant dans l'ordre où les droits rappelés auraient dû normalement influencer ces bases si les déclarations fiscales avaient été correctement souscrites.
BOFIP Garanties liées aux procédures de rectification Déduction en cascade
ATTENTION AU DELAI
Les demandes que les contribuables peuvent présenter doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 77 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
- IMPUTATION DES SUPPLÉMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(Cascade dite « simple »)
- Principe.
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice. Cette déduction est effectuée automatiquement par l'administration dans la proposition de rectification1.
Toutefois, l'article L. 77 du LPF prévoit la possibilité pour le contribuable de renoncer au bénéfice de la déduction en cascade. Cette demande doit être formulée de manière expresse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En ce qui concerne la prescription, cf. n° 7140.
Par ailleurs, la réintégration au bénéfice imposable d'un « profit » sur le Trésor égal au montant de la TVA rappelée est indépendante du mécanisme de la déduction en cascade.
- Exclusion du mécanisme de déduction en cascade dans le cas d'opérations auto-liquidées.
Le deuxième alinéa de l'article L. 77 du LPF exclut l'application du mécanisme de déduction en cascade pour les rappels de TVA portant sur des opérations d'auto liquidation dès lors que la taxe ne constitue pas, dans cette hypothèse, une charge pour l'entreprise.
- Portée de la mesure.
1° Champ d'application.
La mesure concerne tous les rappels portant sur des opérations d'auto liquidation, c'est-à-dire les opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes.
Il s'agit notamment des opérations telles que les acquisitions intracommunautaires, les prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, les achats à des non-assujettis, les transports intracommunautaires de biens meubles, les prestations accessoires aux transports intra-communautaires, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, les prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées à l'article 259 A-3° et 5° du CGI et les livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des articles 257-I et 257-II du même code.
2° Exclusions.
La mesure ne concerne que les rappels de taxe effectivement déductible. Ainsi :
- lorsque l'opération non déclarée n'ouvre pas droit à déduction, le rappel de TVA correspondant demeure dans le champ d'application du mécanisme de la cascade ;
- lorsque l'opération ouvre intégralement droit à déduction, le rappel de TVA correspondant est totalement exclu de ce mécanisme ;
- lorsque l'opération non déclarée ouvre partiellement droit à déduction, seule la partie du rappel qui correspond à la fraction de TVA effectivement déductible est exclue du mécanisme de la cascade.
- IMPUTATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AFFÉRENT AUX BÉNÉFICES COMPRIS DANS LES REHAUSSEMENTS ET RÉPUTÉS DISTRIBUÉS
(Cascade dite « complète »)
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution est établie, à la demande des entreprises, sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Le bénéfice de cette déduction en cascade est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations du contribuable ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler ladite demande.
L'imputation prévue au n° 7215 n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.
La cascade « complète » ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte
Le Conseil d’État a juge que le mécanisme de la cascade ne s’applique pas aux sommes constitutives d’un avantage occulte, dès lors qu’elles ont été directement appréhendées par l’associé et non distribuées en conséquence du rehaussement des bénéfices déclarés par la société.
Lorsque la vérification d’une société passible de l'impôt sur les sociétés fait apparaître des bénéfices considérés comme fiscalement distribués, l’impôt sur le revenu supplémentaire mis à la charge du bénéficiaire peut être établi sur le montant du rehaussement soumis à l’IS, obtenu après déduction des suppléments de taxes sur le chiffre d'affaires puis du montant de l’IS. Cette déduction en cascade, dite « cascade complète », est subordonnée à une demande de la société et au reversement par l’associé, dans la caisse sociale, des sommes nécessaires au paiement des impôts correspondant aux revenus distribués (LPF art. L 77, al. 3).
Ce mécanisme de cascade « complète » ne s’applique que dans l’hypothèse d’une taxation entre les mains d’un associé ou actionnaire de sommes réputées distribuées en conséquence d’un rehaussement des résultats d’une société soumise à l’IS. Les sommes, constitutives d’une libéralité, directement appréhendées par l’associé et taxées entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c du CGI, ne peuvent donc pas en bénéficier.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence excluant la cascade dans le cas où l’associé est imposé, en application de l’article 109, 1-2° du CGI, sur des sommes, non prélevées sur les bénéfices, qu’il a directement appréhendées (CE 20-2-1991 n° 59865).
- CONSÉQUENCES DE LA REMISE EN CAUSE ULTÉRIEURE DES IMPOSITIONS AYANT DONNÉ LIEU À IMPUTATION EN CASCADE
Pour les créances acquises au titre des exercices clos depuis le 31 décembre 2008, les dégrèvements d'impôt suivent les règles de droit commun de rattachement des produits et le montant de ces dégrèvements doit donc être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise (BO 4 A-4-09).
Pour les créances acquises au titre des exercices clos antérieurement au 31 décembre 2008, si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77 du LPF , le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
- CAS DES VÉRIFICATIONS SÉPARÉES
Les dispositions des articles L. 77 du LPF sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts (LPF, art. L. 79).
1 Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la procédure utilisée.
11:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
15 février 2026
Fiscalité des successions internationales Patrick MICHAUD avocat fiscaliste
 patrickmichaud@orange.fr 0607269708
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
24 rue de MADRID 75008
I. Introduction
II. Définition et cadre juridique des successions internationales
III. Loi civile applicable : principe de la résidence habituelle du défunt (Règlement UE 650/2012)
IV. Choix de la loi applicable et testament du défunt
V. Conflits de lois et cas concrets
VI. Fiscalité successorale internationale : conventions fiscales et double imposition
.1. Règles internes françaises (article 750 ter du CGI)
2. Conventions fiscales internationales et prévention de la double imposition
VII. Conclusion : enjeux patrimoniaux et conseils de prudence
SUCCESSION INTERNATIONALE REGIME CIVIL ET FISCAL Patrick MICHAUD
FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN France
conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales
ATTENTION ,
le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequentPAR AILLEURS
Lorsque des biens sont répartis dans plusieurs pays, les autorités fiscales de chaque État peuvent réclamer des droits de succession. Sans mécanisme correctif, cela peut entraîner une double imposition, voire une taxation excessive.1 avr. 2025
DROITS DE SUCCESSION LES REGIMES EXONERATOIRES PERSONNELS ET MATERIELS
SUCCESSIONS INTERNATIONALES
LES DOMICILES CIVILS ET FISCAUX en pdf cliquez
I. Introduction
Lorsqu'un décès présente des liens avec plusieurs pays, on parle de succession internationale. Ce type de situation survient dès qu'un élément d’extranéité est présent : par exemple, le défunt possédait des biens à l’étranger, résidait hors de France, ou comptait des héritiers vivant à l’étrangerparis.notaires.fr. Ces cas sont loin d’être rares – on estime qu’environ 450 000 successions internationales se produisent chaque année dans l’Union européenne, soit une sur dix. Les successions internationales soulèvent des questions complexes de droit international privé (conflits de lois, compétence des tribunaux) et de fiscalité successorale. Cet article propose un tour d’horizon clair et structuré de ces règles, à destination d’un public non spécialisé mais averti, notamment en matière de succession internationale, loi applicable, résidence habituelle, héritage à l’étranger et fiscalité successorale. Nous aborderons successivement le cadre juridique (notamment le Règlement UE 650/2012), le principe de la loi applicable fondé sur la résidence habituelle du défunt, le choix de loi via testament, quelques exemples concrets de conflits de lois, puis les enjeux de la fiscalité internationale des successions, avant de conclure sur les précautions patrimoniales à prendre.
II. Définition et cadre juridique des successions internationales
Une succession est dite internationale lorsqu’elle comporte des attaches avec plusieurs États (nationalité du défunt ou des héritiers, dernier domicile du défunt, localisation des biens, etc.). En présence d’une telle situation, plusieurs systèmes juridiques peuvent prétendre régir la succession, ce qui historiquement entraînait des conflits de lois. Par exemple, avant 2015, la France appliquait deux lois différentes selon la nature des biens : la loi du dernier domicile du défunt pour les biens meubles, et la loi du lieu de situation pour les immeubles. Un même patrimoine pouvait donc être scindé entre plusieurs législations, rendant le règlement de la succession complexe. De plus, les règles de chaque pays varient quant à la détermination des héritiers, des parts réservataires, ou encore quant à la responsabilité pour les dettes du défunt. Il n’est donc pas surprenant que les successions internationales aient donné lieu à des incertitudes et litiges, chaque État pouvant appliquer ses propres principes de droit international privé.
Pour apporter plus de sécurité juridique et simplifier ces successions transfrontalières, l’Union européenne a adopté le Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (dit Règlement Successions). Ce texte, entré en application le 17 août 2015, a profondément harmonisé les règles au sein de l’UE (à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande, qui n’ont pas participé au Règlement). Le Règlement 650/2012 instaure notamment le principe d’unité successorale : une seule loi nationale est appelée à régir l’ensemble de la succession, mettant fin au morcellement entre meubles et immeubles. Par ailleurs, le Règlement définit une juridiction compétente unique (généralement celle du dernier lieu de résidence du défunt) et crée le Certificat Successoral Européen pour faciliter la reconnaissance des droits des héritiers dans les différents pays membres. Il est important de noter que ce Règlement a une portée universelle : il peut conduire à appliquer la loi d’un État tiers non membre de l’UE si les critères le désignent. En dehors du champ d’application du Règlement (par exemple pour les pays non participants ou hors UE), ce sont les règles internes de conflit de lois de chaque État qui continuent de s’appliquer, parfois sur la base de conventions internationales (telles que d’anciennes conventions bilatérales ou la Convention de La Haye de 1989, même si cette dernière n’a pas été largement ratifiée).
III. Loi applicable : principe de la résidence habituelle du défunt (Règlement UE 650/2012)
Le principe central du Règlement UE 650/2012 est que la loi applicable à l’ensemble d’une succession internationale est, par défaut, celle du pays de la dernière résidence habituelle du défunt. Concrètement, cela signifie que si une personne décède en ayant son centre de vie dans un État donné, c’est la loi successorale de cet État qui régira la transmission de tous ses biens, mobiliers comme immobiliers, où que ces biens se trouvent. Ce critère de rattachement unique simplifie considérablement les choses par rapport aux anciennes règles. Par exemple, une personne de nationalité française installée au Portugal au moment de son décès verra sa succession soumise à la loi portugaise pour l’ensemble de son patrimoine (y compris ses éventuels biens situés en France), à moins qu’elle n’ait fait un choix de loi différent de son vivant.
Le Règlement prévoit également une clause d’exception : si, « au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre » que celui de sa résidence habituelle, la loi de cet autre État peut être appliquée à titre exceptionnel. Cette situation demeure rare et nécessite une appréciation au cas par cas. En pratique, la notion de résidence habituelle se définit de manière factuelle : il s’agit du lieu où le défunt avait le centre stable de sa vie (familiale, sociale, professionnelle) au moment du décès. Cette notion peut soulever des questions dans des cas limites (par exemple, une personne vivant entre deux pays), et a déjà fait l’objet de clarifications par la jurisprudence européenne. Néanmoins, pour la majorité des successions, le dernier domicile effectif du défunt permettra de déterminer la loi applicable sans ambiguïté.
Il convient de souligner que l’adoption de la loi de la résidence habituelle unifie le régime applicable à toute succession, quel que soit le type de biens. Cette loi étrangère désignée s’applique même si elle n’est pas celle d’un pays de l’UE (grâce au caractère universel du Règlement). Par exemple, si un défunt avait sa résidence habituelle à Genève, la loi suisse sera appliquée par les autorités d’un pays de l’UE saisi de la succession, alors même que la Suisse est un État tiers. En contrepartie, un citoyen suisse résidant en France peut profiter des mécanismes du Règlement (comme le choix de loi que nous verrons ci-dessous), bien que la Suisse ne soit pas partie au Règlement. Enfin, notons que le Règlement ne s’applique qu’aux questions civiles de succession (partage, administration du patrimoine, etc.) et non aux questions fiscales ni aux régimes matrimoniaux. La fiscalité et les droits du conjoint survivant relevant du régime matrimonial restent donc soumis à d’autres règles, abordées plus loin.
IV. Choix de la loi applicable et testament du défunt
Le Règlement UE 650/2012 offre aux individus une certaine liberté dans l’organisation de leur succession internationale, via la possibilité d’un choix de loi anticipé. En effet, une personne peut de son vivant décider de soumettre sa succession à la loi de sa nationalité (plutôt qu’à celle de sa résidence habituelle). Ce choix de la loi applicable – appelé en latin professio juris – doit être exprimé explicitement dans une disposition à cause de mort, le plus souvent dans un testamentparis.notaires.fr. Il n’est possible de choisir qu’une loi nationale parmi ses nationalités (pour les personnes bi- ou multinationaux, le choix peut porter sur l’une ou l’autre des nationalités détenues).
Cette faculté de professio juris est particulièrement importante pour les expatriés. Beaucoup de personnes vivant à l’étranger préfèreront que leur succession soit régie par la loi de leur pays d’origine, plus familière à leurs yeux. Par exemple, un Français vivant aux États-Unis peut, par testament, stipuler que sa succession sera régie par la loi françaiseparis.notaires.fr. À défaut d’un tel choix, c’est la loi de la résidence habituelle qui s’appliquera par défaut (loi de l’État américain dans cet exemple). Le choix de loi permet donc d’éviter une application automatique d’une loi étrangère qui pourrait réserver des surprises ou des règles moins conformes aux volontés du défunt.
Il est essentiel de formaliser correctement ce choix de loi. Le testament (ou la disposition de dernières volontés) doit mentionner expressément la volonté du disposant de voir telle loi nationale s’appliquer à sa succession. Ce testament devra idéalement être rédigé avec l’aide d’un professionnel (notaire ou avocat) pour en garantir la validité formelle et la conformité aux exigences du Règlement. En effet, le Règlement impose que le choix de loi respecte certaines conditions de validité (notamment en ce qui concerne l’existence et l’interprétation du choix, renvoyant à l’article 22 du Règlement).
À noter : si le défunt a fait un choix de loi en faveur de sa loi nationale, cela peut aussi influencer la compétence juridictionnelle. Les héritiers pourront, dans certains cas, opter pour saisir soit les tribunaux de l’État de la dernière résidence habituelle, soit ceux de l’État de la nationalité choisie. Cela peut s’avérer utile pour régler la succession devant une juridiction familière avec la loi applicable désignée.
En résumé, le testament international est un outil de planification incontournable pour toute personne ayant des intérêts dans plusieurs pays. Il permet d’éviter l’incertitude quant à la loi applicable et de préserver, autant que possible, l’unité de traitement de la succession. Bien entendu, ce choix de loi ne dispense pas de prendre en compte d’autres aspects comme la fiscalité ou les règles impératives locales (par exemple, les règles de réserve héréditaire dans certains pays, voir section suivante).
V. Conflits de lois et cas concrets
Malgré l’harmonisation européenne, des conflits de lois peuvent encore survenir dans les successions internationales, notamment dans des situations complexes ou en dehors du champ du Règlement. Considérons quelques cas concrets pour illustrer les problèmes pratiques :
- Expatrié sans testament : Imaginons une personne de nationalité française qui vivait de longue date à l’étranger (par exemple en Australie) et qui décède sans avoir fait de testament. Du point de vue du droit français, cette succession internationale sera soumise à la loi du dernier domicile (loi australienne) en application des principes du Règlement 650/2012 (l’Australie étant un État tiers, le Règlement conduira à appliquer la loi australienne compétente). Or, le droit australien (de tradition de common law) ne connaît pas la notion de réserve héréditaire pour les enfants, à la différence du droit français. Les enfants du défunt pourraient donc être désavantagés par rapport à ce qu’ils auraient reçu sous la loi française. Ce cas de figure illustre la nécessité pour les expatriés de se renseigner sur les conséquences de la loi étrangère et d’envisager éventuellement un choix de loi en faveur de leur loi nationale pour protéger certains héritiers. En effet, la protection du conjoint et des enfants varie d’un État à l’autre et une même situation familiale peut produire des résultats très différents selon la loi applicable.
- Patrimoine dans plusieurs pays : Supposons un défunt qui possédait des biens immobiliers dans deux pays européens (par ex. en France et en Italie). Si sa résidence habituelle était en France, la loi française s’appliquera à toute succession, y compris aux biens situés en Italie, grâce à l’unification opérée par le Règlement. Les autorités italiennes devraient reconnaître cette loi applicable française, et un notaire français pourrait régler l’ensemble du patrimoine. Cependant, des complexités peuvent surgir si des biens sont situés hors UE, ou dans un pays membre non soumis au Règlement (par ex. un bien au Danemark ou au Royaume-Uni). Dans ces cas, il peut y avoir une scission partielle : la loi française s’appliquera aux biens situés dans les pays couverts par le Règlement, tandis que le bien situé dans le pays exclu sera régi par les règles locales de cet État. Par exemple, un bien immobilier situé au Royaume-Uni (qui ne participe pas au Règlement) sera soumis au droit britannique (qui applique la loi du lieu de l’immeuble). On pourrait donc avoir, pour un même défunt, une double loi applicable : la loi française pour le reste du patrimoine et la loi britannique pour cet immeuble particulier. Ce genre de situation requiert une coordination entre juristes des deux pays et l’utilisation éventuelle du Certificat successoral européen pour prouver la qualité d’héritier en France et dans l’autre État.
- Conflit avec la réserve héréditaire française : Le droit français accorde aux descendants (et à défaut aux parents) un droit à réserve héréditaire, part minimale du patrimoine dont ils ne peuvent être privés. Or, le Règlement permet à un citoyen français résidant à l’étranger de choisir la loi de son pays d’accueil, même si cette loi ignore la réserve. Cela a suscité des inquiétudes sur le risque de contournement de la réserve. En réaction, la France a adopté la loi du 24 août 2021 visant à protéger les héritiers réservataires français. Cette loi (n° 2021-1109) a introduit un alinéa 3 à l’article 913 du Code civil prévoyant un mécanisme de droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, en faveur des enfants réservataires non protégés par la loi étrangère applicable. En simplifiant, si un défunt ayant des liens avec la France laisse une succession régie par une loi étrangère ne garantissant aucune réserve aux enfants, alors ceux-ci peuvent prélever sur les actifs français de la succession la part réservataire qu’ils auraient eue selon la loi française. Ce dispositif est soumis à plusieurs conditions strictes (résidence ou nationalité européenne du défunt ou de l’enfant, absence totale de mécanisme protecteur dans la loi étrangère, etc.). Il constitue une sorte de filet de sécurité pour éviter que des enfants ne soient complètement déshérités du fait de l’application d’une loi étrangère. Néanmoins, cette loi française heurte le principe d’unité successorale du Règlement européen en introduisant, pour les biens en France, l’application partielle de la loi française en lieu et place de la loi étrangère pourtant compétente. Sa conformité au droit de l’UE n’a pas encore été tranchée par la Cour de justice (CJUE) ni par le Conseil constitutionnel. Il s’agit donc d’une zone d’incertitude juridique. Quoi qu’il en soit, cet exemple montre que, même avec un cadre harmonisé, certaines spécificités nationales (comme la protection des héritiers réservataires en France) peuvent créer des conflits de lois résiduels nécessitant une vigilance accrue.
En conclusion de ces exemples, on retiendra que chaque situation internationale a ses particularités. Il est vivement conseillé de consulter un notaire ou un avocat spécialisé en amont pour anticiper les difficultés : choix de loi par testament, aménagement du régime matrimonial, création d’une structure adéquate (comme une société civile immobilière pour des biens à l’étranger, éventuellement), etc. Le professionnel pourra également coordonner le règlement de la succession dans les différentes juridictions concernées.
VI. Fiscalité successorale internationale : conventions fiscales et double imposition
Les aspects fiscaux des successions internationales sont traités séparément des aspects civils. En effet, le Règlement UE 650/2012 n’affecte pas la fiscalité des successions, qui reste du ressort de chaque État. Ainsi, même si une succession est juridiquement régie par une seule loi nationale (par ex. la loi espagnole), chaque pays concerné peut appliquer ses propres droits de succession sur les biens ou les personnes qui le lient à cette succession. Cette indépendance des fiscalités peut conduire à des doubles impositions : deux États (ou plus) peuvent taxer simultanément une même transmission. Par exemple, si un résident français décède en laissant des biens aux États-Unis, la France et les USA sont susceptibles de réclamer un impôt sur une partie du patrimoine.
1. Règles internes françaises (article 750 ter du CGI)
En l’absence de convention fiscale entre la France et l’autre pays concerné, on applique les dispositions internes du Code général des impôts (CGI), en particulier l’article 750 ter qui définit la territorialité de l’impôt en matière de successions et donations. Simplifions ces règles :
- Si le défunt était domicilié fiscalement en France au moment du décès : tous les biens transmis, où qu’ils se trouvent, sont soumis aux droits de succession en France, quel que soit le lieu de résidence des héritiers La France taxe donc le patrimoine mondial du défunt. Toutefois, si des droits de succession ont déjà été acquittés à l’étranger sur certains biens, ces montants peuvent être imputés en déduction de l’impôt français dû (mécanisme de crédit d’impôt prévu à l’article 784 du CGI).
- Si le défunt n’était pas domicilié en France : on distingue deux sous-cas. (a) Héritiers non domiciliés en France : la France ne taxera que les biens situés en France. Les actifs du défunt localisés hors de France ne sont pas imposables en France dans cette configuration. Par exemple, si le défunt résidait à l'étranger et que l'héritier est également non-résident fiscal en France, seuls les biens du défunt situés en France sont imposables. (b) Héritier domicilié en France (depuis au moins 6 ans sur les 10 dernières années) : dans ce cas, même si le défunt était étranger et vivait à l’étranger, tous les biens transmis, en France ou hors de France, sont soumis aux droits de succession français. Cette règle vise à éviter qu’un résident français héritant d’un oncle ou parent à l’étranger ne soit avantagé fiscalement. Cependant, lorsque la France étend ainsi son imposition à des biens situés hors de France (parce qu’un héritier est résident français), l’article 784 du CGI permet également d’imputer les droits acquittés à l’étranger sur ces biens sur l’impôt français. En revanche, si l’héritier n’avait pas la durée minimale de résidence en France (moins de 6 ans sur 10), seuls les biens situés en France seront taxés.
En synthèse, hors convention internationale, la France taxe tous les biens si le défunt ou l’héritier principal est fiscalement résident en France, et ne taxe que les biens situés en France dans les autres cas. Ces dispositions ont pour but d’éviter les situations de non-imposition, mais elles engendrent potentiellement des doubles impositions lorsque d’autres pays taxent également les biens en question selon leurs propres critères (par exemple lieu de situation de l’immeuble ou nationalité du défunt).
2. Conventions fiscales internationales et prévention de la double imposition
Pour remédier à ces risques de double imposition, la France a conclu de nombreuses conventions fiscales bilatérales en matière de droits de succession (environ 30 conventions spécifiques aux successions sont en vigueur, parmi un réseau de plus de 120 conventions fiscales couvrant divers impôts). Lorsqu’une convention existe entre la France et un autre État, ses stipulations prévalent sur le droit interne. En général, ces conventions répartissent le pouvoir d’imposer entre les États signataires selon des critères précis : typiquement, l’immobilier est taxable dans le pays où il est situé, les biens mobiliers peuvent être imposés dans le pays de résidence du défunt, etc., avec des mécanismes de crédit d’impôt pour éviter la double taxation. Chaque convention ayant été négociée séparément, leur contenu n’est pas homogène. Il est donc impératif de se reporter au texte de la convention applicable à chaque situation. Par exemple, la convention fiscale France–États-Unis du 24 novembre 1978 prévoit une répartition spécifique pour l’imposition des successions franco-américaines (avec un crédit d’impôt accordé par le pays de résidence pour l’impôt payé à l’étranger). De même, la convention France–Monaco du 1er avril 1950 ne s’applique qu’aux successions de ressortissants français ou monégasques, ce qui crée une lacune pour les ressortissants d’un pays tiers décédant dans l’un de ces États. Cet exemple concret, où un Suisse domicilié à Monaco avec un immeuble en France n’entre pas dans le champ de la convention franco-monégasque, montre qu’il faut toujours vérifier attentivement le champ d’application personnel et territorial des conventions.
Même en présence d’une convention, certaines situations peuvent rester partiellement non couvertes (par exemple, beaucoup de conventions ne traitent pas des donations, ou excluent certains impôts locaux). Dans ces cas, on revient aux règles internes. Par ailleurs, l’application d’une convention fiscale n’a pas d’effet sur la loi civile applicable à la succession. On peut donc avoir une loi civile étrangère gouvernant la dévolution successorale, tout en appliquant la convention fiscale pour répartir les droits de succession entre États – les deux plans juridique et fiscal coexistent avec leurs propres règles.
En pratique, pour une succession internationale, il est crucial d’identifier s’il existe une convention fiscale entre la France et l’autre pays impliqué. L’administration fiscale française (notamment la Direction des Impôts des Non-Résidents - DINR) peut fournir des renseignements, et le site officiel BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques, accessible sur bofip.impots.gouv.fr) publie la doctrine administrative détaillée sur le sujet. Le portail du ministère des finances impots.gouv.fr propose également une rubrique dédiée aux particuliers non-résidents (impôts internationaux) pour guider les contribuables. En l’absence de convention, il conviendra de se référer strictement aux articles 750 ter et suivants du CGI et aux éventuels crédits d’impôt unilatéraux disponibles (formulaire Cerfa n°2740 pour imputer les droits payés à l’étranger, par exemple).
VII. Conclusion : enjeux patrimoniaux et conseils de prudence
Les successions internationales comportent des enjeux patrimoniaux majeurs pour les familles : différences dans la désignation des héritiers, conflits de lois possibles entre législations, lourdeurs administratives multiples, sans oublier le risque de double imposition fiscale. Face à cette complexité, la clé réside dans l’anticipation et le conseil avisé. Le Règlement UE 650/2012 a indéniablement simplifié et unifié le cadre civil au sein de l’Europe, en posant des règles claires sur la loi applicable (résidence habituelle du défunt ou loi nationale choisie) et la compétence des juridictions. Cependant, il ne supprime pas tous les problèmes : la diversité des régimes juridiques mondiaux subsiste, et certaines valeurs fondamentales (telles que la réserve héréditaire française) peuvent nécessiter des ajustements spécifiques. De même, la sphère fiscale reste fragmentée entre États et requiert une analyse distincte.
Le meilleur conseil est de planifier en amont. Toute personne ayant des attaches dans plus d’un pays (biens à l’étranger, expatriation, enfants vivant hors de France, etc.) devrait consulter un professionnel du droit (notaire, avocat) afin de : (a) faire le point sur la loi qui s’appliquerait par défaut à sa succession et sur les conséquences éventuelles (par exemple, existence ou non d’une réserve héréditaire, part du conjoint, etc.), (b) le cas échéant, rédiger un testament international pour choisir la loi la plus appropriée à sa situation familiale et patrimoniale, (c) étudier les implications fiscales et optimiser la transmission pour éviter les doubles impositions (donations de son vivant, assurance-vie, usage des conventions fiscales…), et (d) plus généralement, s’assurer que son patrimoine est structuré de façon à faciliter le règlement futur (par exemple, vérifier les titres de propriété, prévoir un mandat posthume ou une convention funéraire internationale si besoin, etc.).
En suivant ces précautions, on minimise les risques de litiges entre héritiers de différentes nationalités et de contentieux fiscaux. Les notaires, en lien avec leurs homologues étrangers si nécessaire, jouent un rôle central dans cet accompagnement. Comme le souligne le Conseil supérieur du notariat, préparer la transmission de son patrimoine dans un contexte international requiert une approche globale, à la fois civile et fiscale, afin d’éviter des déconvenues et de protéger au mieux les intérêts des proches. En définitive, les règles des successions internationales, bien que techniques, visent à assurer une certaine justice et prévisibilité dans un monde où les personnes et les biens circulent de plus en plus librement. S’en informer et s’entourer de conseils éclairés est la meilleure démarche pour aborder sereinement ces questions.
Encadré – Points clés à retenir :
- Loi applicable: Par défaut, la succession est régie par la loi du pays de la résidence habituelle du défunt (Règlement UE 650/2012). Le défunt peut toutefois choisir par testament la loi de son pays dont il a la nationalité pour sa succession.
- Unité de la succession: Une seule loi s’applique à l’ensemble du patrimoine, meubles et immeubles, évitant de scinder la succession entre plusieurs législations. Les pays de l’UE (hors Danemark, Irlande, Royaume-Uni) appliquent ce principe d’unité successorale.
- Conflits de lois résiduels: Des difficultés peuvent subsister si des biens sont situés dans des États non couverts par le Règlement ou si la loi applicable étrangère va à l’encontre de principes chers à un pays (ex : réserve héréditaire en France). La loi française a instauré en 2021 un mécanisme particulier pour protéger les enfants non réservataires lorsque la loi étrangère applicable ne les protège pas.
- Fiscalité distincte: La loi civile applicable n’a pas d’effet sur la fiscalité successorale. Chaque État peut taxer selon ses règles (domicile fiscal du défunt ou des héritiers, localisation des biens). Il faut vérifier les conventions fiscales bilatérales pour éviter les doubles impositions. En l’absence de convention, l’article 750 ter CGI prévoit que la France taxe les successions selon le domicile du défunt et des héritiers et la situation des biens, avec des crédits d’impôt possibles.
- Conseils de prudence: Anticipez ! Si vous avez un héritage à l’étranger ou des intérêts dans plusieurs pays, consultez un notaire. Rédigez un testament avec choix de loi si nécessaire, et informez-vous sur la fiscalité applicable (service-public.fr, notaires.fr, BOFiP, etc.). Une planification patrimoniale internationale évite bien des écueils et assure une transmission conforme à vos volontés et optimalisée fiscalement.
Sources officielles utiles :
- Service Public (fiche Décès à l’étranger – Successions) – Vos droits et démarches : Successions internationales (expliquant la loi applicable et les formalités) – https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16658
- Légifrance (Code civil et Code général des impôts) – Texte du Règlement UE 650/2012paris.notaires.fr ; article 750 ter du CGI sur la territorialité fiscale; loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 (réserve héréditaire)
- Notaires de France (dossiers expatriation) – Le règlement UE n°650/2012 sur les successions internationales ; Donations et successions internationales : quelle fiscalité ?
- EUR-Lex – Texte intégral du Règlement (UE) 650/2012 sur les successions (multilingue) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0650
- BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) – Documentation fiscale officielle en ligne (voir notamment BOI-ENR-DMTG-10-10-30 sur l’article 750 ter, et BOI-ENR-DMTG-10-50 sur les conventions fiscales) – https://bofip.impots.gouv.fr
11:04 | Tags : fiscalite des successions internationales patrick michaud avoc | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
Les donations internationales : enjeux fiscaux et cadre juridique français
Lorsqu’une donation présente un élément d’extranéité – par exemple un donateur et un donataire résidant dans des États différents, ou des biens donnés situés à l’étranger – on parle de donation internationale. Ces situations soulèvent des questions complexes, tant sur le plan civil que fiscal. Chaque pays appliquant sa propre législation aux mutations à titre gratuit (donations, successions) pour les biens sur son territoire ou à l’égard de ses résidents, l’enjeu principal est d’éviter une double imposition de la même donation. En l’absence de coordination, un même don peut en effet être taxé deux fois : par le pays de résidence du donateur, par celui du donataire, et/ou par le pays où se situent les biens transmis. Les critères déterminants pour la fiscalité d’une donation internationale sont donc la résidence fiscale des parties, la localisation des biens donnés et le lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don. Nous examinons ci-dessous le cadre juridique et fiscal en France, le principe de territorialité de l’impôt sur les donations, l’impact des conventions fiscales internationales, les démarches déclaratives requises, ainsi que l’importance de ces critères et le rôle de l’avocat fiscaliste pour sécuriser ces opérations.
Définition et enjeux des donations internationales
Dès qu’une donation comporte un élément international, il faut déterminer quel droit s’applique et comment sera traitée la fiscalité. Sur le plan civil, cela concerne la validité et les modalités du don (loi applicable, éventuelle exigence de forme notariale, etc.). Sur le plan fiscal, il s’agit d’identifier quel État a le droit d’imposer la transmission et selon quelles règles. Une donation internationale est généralement soumise aux lois fiscales de plusieurs pays à la fois, ce qui crée un risque de double imposition. Par exemple, un donateur résident en France qui donne un bien immobilier situé à l’étranger à un enfant vivant aux États-Unis pourrait en théorie être confronté aux impôts sur les donations de la France (en tant que pays de résidence du donateur) et des États-Unis (en tant que pays de résidence du donataire, ou de situation du bien). De même, un résident étranger donnant un bien situé en France peut déclencher l’impôt français et l’impôt du pays du donateur. Sans accord entre les États, la double taxation peut alourdir considérablement le coût fiscal de la donation, voire dissuader de réaliser l’opération.
Le principal défi en matière de donations internationales est donc d’éviter qu’un même don soit taxé deux fois. Chaque pays utilise des critères de rattachement différents pour imposer les donations : certains fiscs considèrent la résidence du donateur, d’autres la résidence du donataire, d’autres la localisation du bien donné, et parfois même la nationalité. Par conséquent, une donation transfrontalière peut être simultanément soumise aux législations de deux États si chacun retient un critère de taxation différent (par ex. l’un impose tout don fait par un résident, l’autre impose tout bien situé sur son sol) – d’où l’importance d’identifier le cadre juridique applicable et de recourir aux instruments juridiques disponibles pour éliminer la double imposition.
Le cadre juridique et fiscal français des donations internationales
En France, les donations entre vifs sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (droits de donation) prévus par le Code général des impôts (CGI). Le cadre juridique français applicable comprend les dispositions internes du CGI – notamment le principe de territorialité de l’impôt sur les donations, les règles d’assiette (valorisation des biens donnés), les abattements et tarifs en fonction du lien de parenté – ainsi que, le cas échéant, les conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et d’autres pays pour éviter les doubles impositions. En pratique, on appliquera d’abord les dispositions d’une convention internationale si elle existe entre la France et l’autre État concerné. S’il n’existe pas de convention relative aux droits de mutation, les règles fiscales françaises s’appliquent pleinement (et parallèlement, l’autre État appliquera son propre droit interne).
La France dispose d’une administration fiscale centralisée et de ressources officielles en ligne pour informer les contribuables. Le site de l’administration fiscale impots.gouv.fr (https://www.impots.gouv.fr) et le portail gouvernemental Service-Public.fr (https://www.service-public.fr) mettent à disposition fiches pratiques et formulaires concernant les donations. Ces sources officielles détaillent notamment les obligations déclaratives, les abattements applicables et fournissent les textes de loi à jour, ce qui est précieux pour les contribuables confrontés à une situation de donation internationale.
Le principe de territorialité de l’impôt sur les donations
En droit interne français, le champ d’application territorial de l’impôt sur les donations est fixé par l’article 750 ter du Code général des impôts (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304360). Ce principe de territorialité détermine dans quels cas une donation sera imposable en France. En résumé :
- Lorsque le donateur est domicilié fiscalement en France, tous les biens donnés sont soumis aux droits de donation français, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger. Autrement dit, la France taxe l’ensemble des donations consenties par ses résidents, où que se trouvent les actifs transmis. C’est le cas prévu par l’article 750 ter, 1° du CGI. Il importe peu que le bénéficiaire du don soit ou non résident français : dès lors que le donateur est domicilié en France, la donation est imposable en France sur sa valeur mondiale. (En pratique, si des droits de donation ont été acquittés à l’étranger sur un bien situé hors de France, la loi française permet d’imputer ces montants sur l’impôt dû en France afin d’éviter une double imposition intégrale – nous y reviendrons.)
- Si le donateur n’est pas domicilié en France ET que le donataire n’est pas domicilié en France, alors seuls les biens situés en France sont imposables aux droits de donation en France. Les biens meubles ou immeubles situés hors de France échappent à l’impôt français dans ce scénario. Par exemple, un donateur résident en Belgique qui fait une donation à un bénéficiaire également non résident de France ne sera taxé en France que si la donation porte sur des actifs situés en France (immeuble, comptes bancaires, valeurs mobilières françaises, etc.). C’est le cas de l’article 750 ter, 2° du CGI.
- Si le donateur n’est pas domicilié en France MAIS que le donataire (bénéficiaire) est domicilié fiscalement en France, une règle spécifique s’applique : la France impose la donation portant sur des biens situés en France ou hors de France, à condition que le donataire ait été fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 années au cours des 10 ans précédant la donation. Autrement dit, un donataire qui est un résident de longue durée en France (six ans sur dix) sera redevable des droits de donation français sur l’ensemble des biens reçus, même si le donateur vit à l’étranger et même si les biens transmis sont situés hors de France. C’est le cas prévu par l’article 750 ter, 3° du CGI. Cette disposition vise à éviter que des personnes installées en France de façon durable ne reçoivent des donations importantes de l’étranger sans aucune imposition française.
En synthèse, la France revendique le droit d’imposer : (1) toutes les donations émanant d’un résident fiscal français, (2) les donations de biens situés en France (même si le donateur est non-résident), et (3) les donations reçues par un résident français de longue durée (même si le donateur est non-résident). Ces critères sont alternatifs : si l’un d’eux est rempli, la donation entre dans le champ d’imposition français. À l’inverse, une donation échappe aux droits français si aucun de ces critères n’est rempli (par exemple, donateur étranger, donataire étranger, biens situés hors de France). Notons que la notion de domicile fiscal en France renvoie aux critères de l’article 4 B du CGI (lieu du foyer ou séjour principal, activité professionnelle en France, centre des intérêts économiques, etc.), identiques à ceux utilisés pour l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, la définition de biens situés en France est large : les immeubles en France sont visés bien sûr, mais aussi les actifs financiers considérés comme français (par exemple, des parts ou actions de sociétés ayant leur siège en France, des créances sur un débiteur établi en France, etc. sont réputées situées en France selon l’article 750 ter).
Exemple : un parent résidant fiscalement en Suisse fait une donation de titres d’une société française cotée à son enfant domicilié en Belgique. Ici, le donateur n’est pas résident français, le donataire n’est pas non plus résident français, mais les titres sont des valeurs mobilières françaises (société ayant son siège en France). Selon l’article 750 ter 2° CGI, ces titres, bien que « incorporels », sont des biens situés en France aux yeux de la loi fiscale française. La donation sera donc imposable en France sur la valeur des titres. En parallèle, la Belgique imposera la donation du fait que le donateur y réside (droit d’enregistrement de 3 % ou 3,3 % selon la Région). Faute de convention entre la France et la Belgique sur les donations, ce don sera doublement taxé (France et Belgique) – nous voyons ainsi concrètement l’enjeu de la double imposition.
Il est important de souligner que ces règles de territorialité fixées par l’article 750 ter du CGI s’appliquent sous réserve des conventions fiscales internationales. Si une convention bilatérale existe entre la France et un autre État pour les droits de succession et/ou de donation, ses dispositions priment sur le droit interne français. Nous examinerons plus loin l’impact de ces conventions, souvent déterminantes pour atténuer la portée du critère de résidence du donataire mentionné ci-dessus.
Abattements et barèmes : l’impact des liens familiaux
Lorsqu’une donation est imposable en France en vertu des principes ci-dessus, son régime fiscal interne (hors convention) obéit aux règles habituelles des droits de donation en ce qui concerne le calcul de l’impôt. Le montant des droits dus dépend de la valeur des biens donnés et surtout du lien de parenté entre le donateur et le donataire. En France, le système est progressif et intègre des abattements (franchises) en fonction du degré de parenté, ainsi qu’un barème d’imposition par tranche.
- Chaque bénéficiaire a droit, tous les 15 ans, à un abattement sur la part de donation reçue de chaque donateur, ce qui réduit la base imposable. Par exemple, en ligne directe (parent-enfant), chaque enfant peut recevoir 100 000 € de chaque parent sans payer de droits de donation, grâce à un abattement personnel de 100 000 € applicable aux donations parent->enfant. Pour un conjoint ou partenaire de PACS, l’abattement est de 80 724 € sur l’ensemble des dons reçus de l’époux/partenaire. Pour une donation à un petit-enfant, l’abattement est de 31 865 € (montant accordé à chaque petit-enfant par grands-parents). Un frère ou sœur bénéficiaire d’une donation dispose d’un abattement de 15 932 €. Un neveu ou une nièce (en l’absence de descendance du donateur) a un abattement de 7 967 €. En revanche, pour une personne sans lien de parenté (ou parenté très éloignée) avec le donateur, il n’existe pas d’abattement général (seules certaines situations particulières comme les personnes handicapées peuvent ouvrir droit à un abattement spécifique de 159 325 €). Ces montants d’abattements sont actualisés par la loi et consultables sur le site officiel (voir par exemple la fiche Service-Public « Droits de donation – Biens imposables et exonérations » sur https://www.service-public.fr).
- Après application de l’abattement, le restant de la donation est taxable selon un barème progressif. Les taux varient selon le lien de parenté et selon la tranche de valeur transmise. En ligne directe (enfants, parents, petits-enfants), le barème va de 5 % (sur la tranche jusqu’à 8 072 €) à 45 % (au-delà de 1 805 677 € de part taxable, tranche maximale). Par exemple, un parent qui donne 500 000 € à son enfant : après abattement de 100 000 €, la part taxable de 400 000 € sera imposée par tranches (5 % sur les premiers 8 072 €, 10 % sur la tranche suivante, etc., jusqu’à 45 % sur la portion au-delà de 552 324 €). Entre époux ou partenaires PACS, les tranches de taxation sont les mêmes qu’en ligne directe (5 % à 45 %), après l’abattement de 80 724 €. Entre frères et sœurs, le barème spécifique prévoit des taux de 35 % puis 45 % (après abattement de 15 932 €). Entre parents jusqu’au 4e degré (oncles/neveux, cousins), un taux unique de 55 % s’applique au-dessus de l’abattement éventuel (ex: 7 967 € pour les neveux). Enfin, pour les donations entre personnes non parentes (ou au-delà du 4e degré), le taux forfaitaire est de 60 % sans abattement. Autrement dit, la fiscalité française des donations favorise clairement la transmission au sein de la famille proche (lignes directes et conjoints) par des abattements élevés et des taux plus faibles, tandis que les transmissions hors cercle familial proche supportent une taxation très lourde (60 %).
Il convient de noter que le conjoint survivant est exonéré de droits de succession en France, mais pas totalement exonéré de droits de donation : pour les donations entre époux, seul l’abattement de 80 724 € s’applique et le reste est taxé (contrairement aux successions entre époux qui sont exonérées depuis 2007). Cela peut sembler paradoxal, mais c’est la loi actuelle : aider son conjoint de son vivant via une donation peut générer des droits, là où le même transfert au décès serait exonéré. Cet aspect mérite d’être pris en compte dans la stratégie patrimoniale.
En résumé, le lien de parenté est un facteur crucial pour le coût fiscal d’une donation : à valeur transmise égale, une donation parent-enfant bénéficiera d’une franchise importante et d’un barème modéré, alors qu’une donation à un tiers sans lien subira 60 % d’imposition dès le premier euro (après un petit abattement quasi-nul). Ainsi, dans un contexte international, la composition de la famille (enfants, neveux, etc.) et la qualité du bénéficiaire influencent fortement la planification : il peut être opportun d’échelonner les dons dans le temps pour renouveler les abattements tous les 15 ans, ou de privilégier certaines formes (don familial d’argent exonéré dans la limite de 31 865 € sous conditions d’âge, etc.). Un avocat fiscaliste pourra conseiller utilement sur ces optimisations familiales.
Les conventions fiscales bilatérales contre la double imposition
Pour atténuer les conflits d’imposition entre deux États, la France a conclu avec certains pays des conventions fiscales internationales spécifiques aux droits de succession et de donation. Ces traités bilatéraux visent à éviter la double imposition des mutations à titre gratuit en répartissant le pouvoir d’imposer entre les deux États signataires. En général, les conventions prévoient des règles de répartition fondées sur la résidence du donateur (ou du défunt, s’il s’agit d’une succession) et sur la situation géographique des biens. Contrairement au droit interne français qui, on l’a vu, prend aussi en compte la résidence du donataire, les conventions franco-étrangères ignorent le critère du bénéficiaire : elles se concentrent sur la personne du donateur (ou défunt) et sur les biens. Typiquement, une convention va déterminer qu’un donateur domicilié dans l’État A ne sera imposable sur ses donations que par l’État A, sauf pour les biens immobiliers situés dans l’État B, lesquels pourront être imposés par l’État B. En contrepartie, si l’État B taxe ces immeubles, l’État A accordera un crédit d’impôt pour éliminer la double imposition. De même, un donateur domicilié dans l’État B ne sera taxé en France (État A dans cet exemple) que sur les biens situés en France. Ce mécanisme écarte donc l’application de l’article 750 ter, 3° du CGI : la France renonce à imposer un donateur étranger pour le motif que le donataire est résident français, dès lors qu’une convention attribue à l’autre État le droit principal d’imposer. En pratique, les conventions font primer la règle conventionnelle sur la loi interne.
Exemple : la convention fiscale franco-allemande du 12 octobre 2006 (entrée en vigueur en 2009) relative aux successions et donations stipule qu’en cas de donation transfrontalière entre la France et l’Allemagne, les biens sont répartis en deux catégories : masse imposable en France et masse imposable en Allemagne, en fonction de critères de situation des biens et de résidence du donateur. Cette convention prévoit un système de crédit d’impôt : si la France est le pays du domicile du donateur, elle accorde un crédit égal aux droits payés en Allemagne sur les biens situés en Allemagne, et vice-versa. Ce type d’accord empêche que le même bien soit taxé deux fois. La convention franco-allemande couvre aussi bien les successions que les donations – ce n’est pas le cas de toutes les conventions, certaines ne traitant que des successions.
La France a conclu relativement peu de conventions incluant les donations. Selon les données disponibles, environ 36 conventions fiscales couvrent les successions, mais seulement 7 ou 8 d’entre elles incluent également les donations. Parmi les pays ayant une convention avec la France englobant les donations, on peut citer : l’Allemagne (2006), les États-Unis (traité de 1978), l’Italie (convention de 1990, pour les successions et donations concernant les immeubles), la Suède (convention de 1939, à noter cependant que la Suède a depuis supprimé ses droits de succession/donation), les Pays-Bas (convention de 1959), etc. En revanche, certains pays proches n’ont pas de convention avec la France en matière de droits de donation – ce qui est source de double imposition potentielle. Par exemple, la France et la Belgique n’ont conclu aucun traité concernant les donations. Il existe bien une convention franco-belge de 1953 (révisée en 2014) contre la double imposition en matière de successions, mais elle ne s’applique pas aux donations entre vifs. Ainsi, comme on l’a illustré plus haut, une donation entre un résident belge et un autre résident belge portant sur un bien en France sera imposable en France et en Belgique faute de traité – la double imposition ne pouvant alors être éliminée que par des mécanismes internes limités (en France, imputation éventuelle de droits étrangers seulement si les conditions de l’article 784 du CGI sont remplies, voir section suivante). De même, la convention fiscale franco-suisse signée en 1953 ne couvrait que les successions et pas les donations : une donation franco-suisse pouvait donc être taxée dans les deux pays. D’ailleurs, cette convention franco-suisse a été dénoncée par la France et a cessé de s’appliquer en 2015, ce qui signifie qu’à présent aucune convention n’est en vigueur entre la France et la Suisse pour les successions ou donations – rendant cruciale la planification fiscale dans les situations franco-suisses pour éviter les doubles prélèvements.
Il est important de lire attentivement le texte d’une convention fiscale applicable, car chaque traité a son périmètre et ses spécificités. Certaines conventions couvrent uniquement les successions et non les donations (cas fréquent), ou bien ne s’appliquent qu’aux impôts sur la fortune et non aux droits de mutation. D’autres conventions ont un champ d’application personnel restreint : par exemple, la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 relative aux droits de succession ne s’applique qu’aux successions de ressortissants français ou monégasques – elle exclut les ressortissants tiers, même résidents à Monaco ou en France. Ainsi, un Suisse domicilié à Monaco qui fait une donation de biens français n’est protégé par aucune convention et cumule les taxes française et monégasque éventuelles. Chaque situation doit donc être analysée au regard du traité éventuellement applicable et de ses avenants (certains traités ont été modifiés par des protocoles additionnels au fil du temps).
Lorsque la donation est couverte par une convention fiscale, celle-ci prévaut sur la loi interne. L’article 750 ter du CGI s’applique « sous réserve des dispositions des conventions internationales » comme le rappelle l’administration fiscale. Concrètement, si la convention dit que tel bien n’est imposable que dans l’État étranger, la France ne le taxera pas, même si en l’absence de traité l’article 750 ter y aurait soumis ce bien (c’est souvent le cas pour un bien situé hors de France reçu par un résident français : sans traité, la France l’impose via le critère du donataire résident; avec un traité, la France peut renoncer à cette imposition). Pour éliminer la double imposition, les conventions prévoient généralement soit un système d’exonération (un État renonce à imposer certains biens) soit un système de crédit d’impôt imputable. La méthode du crédit est la plus courante dans les conventions signées par la France : l’un des États accorde un crédit égal à l’impôt payé dans l’autre État sur les biens que les deux pourraient imposer. Par exemple, la France imputera sur les droits de donation dus en France le montant des droits acquittés à l’étranger sur un bien qui, selon la convention, est imposable dans cet autre État tout en restant imposable en France. Cette imputation se fait dans la limite de l’impôt français correspondant à ce bien. Ainsi, le bénéficiaire ne paie au total que le plus élevé des deux impôts nationaux, pas la somme des deux.
Un autre mécanisme rencontré dans certaines conventions est la règle du taux effectif. Cela signifie que lorsqu’un pays accorde une exonération sur une partie de l’héritage ou de la donation en vertu du traité, il peut néanmoins calculer l’impôt sur la partie qu’il taxe en appliquant le taux correspondant à la totalité du patrimoine. Par exemple, supposons qu’une convention stipule que la France n’impose pas les biens situés à l’étranger reçus par un résident français, mais peut tenir compte de ces biens pour déterminer le taux applicable aux biens situés en France. La France calculera alors le taux comme si tous les biens étaient imposables (ce qui donne un taux marginal potentiellement plus élevé), puis appliquera ce taux moyen aux seuls biens imposables en France. Cette clause de taux effectif, prévue dans certaines conventions, garantit que le contribuable ne bénéficie pas d’un taux réduit du fait qu’une partie de son patrimoine échappe à l’impôt français. Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) mentionne cette possibilité de taux effectif dans le contexte des conventions sur les successions et donations (voir BOI-ENR-DMTG-10-50-70).
En conclusion, les conventions fiscales internationales sont un outil essentiel pour gérer les donations internationales. Toutefois, leur nombre est limité et leur couverture inégale. En l’absence de convention, la double imposition n’est atténuée en France que par des mécanismes internes partiels, tels que l’imputation prévue à l’article 784 du CGI : lorsque la France taxe une donation en raison du domicile du donateur ou du donataire (cas 1° ou 3° de l’article 750 ter), elle permet de déduire les droits de mutation payés à l’étranger sur les biens situés hors de France, à hauteur de l’impôt français dû sur ces biens. Cette règle d’imputation évite qu’un même bien soit taxé doublement, mais elle nécessite que le contribuable ait effectivement acquitté un impôt étranger. En outre, elle ne s’applique pas si la France n’a taxé que des biens français (cas où le donateur et le donataire sont étrangers et seuls des biens en France sont imposés en France – là, il n’y a pas d’imposition française sur des biens hors de France, donc pas de crédit possible). Ainsi, dans le scénario franco-belge évoqué, la France permettrait d’imputer l’impôt belge payé sur les titres étrangers s’ils avaient été imposables en France, mais en réalité seuls les titres français sont imposés par la France (sans double assiette), donc l’imputation ne joue pas et le bien français reste doublement taxé (3% en Belgique + barème français). La planification via des conventions ou des montages adaptés est donc primordiale pour éviter ces écueils.
Pour connaître la liste et le contenu des conventions en vigueur, on pourra consulter la documentation officielle (par exemple le BOFiP ou le site Légifrance listant les conventions internationales). Un document de référence est la fiche BOFiP référencée BOI-INT-DG-20-20 du 12 septembre 2012 (accessible sur le site impots.gouv.fr : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1230-PGP.html/identifiant=BOI-INT-DG-20-20-20120912), qui présente les dispositions des conventions internationales en matière de successions et donations et explique comment celles-ci priment sur l’application du CGI. Il est fortement conseillé de se faire accompagner par un conseil fiscal pour interpréter correctement une convention et en tirer parti.
Démarches déclaratives et obligations fiscales
La dimension internationale d’une donation n’exonère pas des obligations déclaratives en France. Dès lors qu’une donation est taxable en France (selon les critères de territorialité vus plus haut), il faut procéder aux déclarations et paiements de droits comme pour toute donation, avec toutefois quelques particularités logistiques.
En règle générale, en France, une donation doit faire l’objet d’un acte notarié lorsqu’elle porte sur des biens immobiliers. Pour les biens mobiliers (sommes d’argent, titres, meubles), l’intervention d’un notaire n’est pas obligatoire : on parle alors de don manuel (don de la main à la main). Dans le contexte national, un don manuel peut être simplement régularisé par une déclaration fiscale. Dans un contexte international, il arrive souvent que le don prenne la forme d’un acte étranger (par exemple, un acte notarié passé devant notaire en Belgique, en Suisse, etc., ou encore une simple remise de fonds de compte à compte).
Si la donation fait l’objet d’un acte notarié en France, le notaire se charge automatiquement de sa déclaration et du paiement des droits au Trésor français. L’acte est enregistré et les droits de donation sont acquittés par le notaire pour le compte des parties. Le notaire français est habitué à traiter les règles fiscales : il appliquera les abattements appropriés, le tarif, etc., et il mentionnera dans l’acte le paiement des droits.
Si la donation est constatée par un acte notarié à l’étranger, il appartient au bénéficiaire (donataire) d’en informer l’administration fiscale française si la donation est imposable en France. En pratique, cela se fait en souscrivant une déclaration de dons sur le formulaire adéquat et en s’acquittant des droits dus. Par exemple, dans le cas d’une donation réalisée devant notaire en Belgique (acte notarié belge) qui est taxable en France (parce que portant sur un bien situé en France, comme dans l’exemple des titres français), le donataire doit déposer une déclaration fiscale en France dans les trois mois suivant la signature de l’acte étranger, accompagnée du paiement des droits de donation français. Cette déclaration se fait au moyen du formulaire n°2735 Déclaration de don manuel (téléchargeable sur impots.gouv.fr : https://www.impots.gouv.fr/formulaire/2735/declaration-de-don-manuel) en cochant la case appropriée pour les actes notariés passés à l’étranger. Le formulaire et le paiement doivent être adressés au service des impôts compétent, en l’occurrence la recette des non-résidents (10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex) qui gère les dossiers fiscaux des personnes non domiciliées en France.
Si la donation prend la forme d’un don manuel pur et simple (sans acte notarié) – par exemple un virement bancaire d’un parent à un enfant – il est fortement recommandé de la déclarer spontanément à l’administration fiscale. Juridiquement, le bénéficiaire d’un don manuel n’est pas obligé de le révéler immédiatement : en l’absence de déclaration, l’impôt ne sera perçu que plus tard, notamment lors du décès du donateur (le don non déclaré réapparaît alors pour être taxé dans la succession) ou en cas de contrôle fiscal. Cependant, ne pas déclarer expose à des intérêts de retard et éventuellement à des pénalités lors de la taxation ultérieure. De plus, déclarer le don permet de donner date certaine à l’opération et de faire démarrer le délai de 15 ans au-delà duquel les abattements se renouvellent. En pratique, pour déclarer un don manuel volontairement, le donataire doit remplir le formulaire n°2735 précité et l’envoyer au service des impôts de son domicile dans le délai d’un mois suivant la révélation du don à l’administration (généralement on considère que la révélation coïncide avec l’envoi du formulaire). Si aucun droit n’est dû (par exemple don de 50 000 € d’un parent à un enfant, intégralement couvert par l’abattement de 100 000 €), la déclaration permettra d’enregistrer officiellement le don sans paiement, ce qui bloquera le point de départ du délai de 15 ans pour l’abattement. Si des droits sont dus (don dépassant l’abattement), ils devront être payés lors du dépôt de la déclaration.
Il existe également une modalité particulière de déclaration appelée “révélation de don manuel avec option pour le paiement différé ou fractionné”. Cette option s’exerce via le formulaire n°2734 (Cerfa 11278) intitulé Révélation de don manuel d’une valeur supérieure à 15 000 € – Option pour le paiement différé ou fractionné des droits de donation (disponible sur impots.gouv.fr : https://www.impots.gouv.fr/formulaire/2734/declaration-de-don-manuel-option-pour-differement). En termes simples, ce dispositif permet, pour les dons manuels importants, de déclarer le don tout de suite mais de ne payer les droits qu’ultérieurement, généralement au décès du donateur (ou de façon échelonnée). Concrètement, cela intéresse les donataires qui souhaitent bénéficier de l’abattement immédiatement et officialiser la donation, sans supporter immédiatement la charge fiscale. Les droits de donation ainsi différés seront recouvrés à l’issue de la période ou de l’événement convenu (par exemple, un mois après le décès du donateur, ou en plusieurs échéances annuelles si un fractionnement a été accordé). Cette option doit être formellement demandée sur le formulaire 2734 lors de la révélation du don. Naturellement, des intérêts peuvent s’appliquer pendant le report. Ce mécanisme du paiement différé ou fractionné s’apparente à un crédit accordé par le fisc et doit respecter les conditions prévues aux articles 404 bis et suivants de l’annexe III du CGI (il est notamment réservé aux donations dont la valeur excède 15 000 €, et nécessite des garanties financières si le différé va au-delà de 5 ans).
Du point de vue pratique, toutes ces déclarations (formulaires 2735 ou 2734) peuvent désormais être effectuées en ligne sur le site des impôts, via l’espace Particulier, ce qui simplifie les démarches pour les non-résidents et permet de télérégler les droits. Le site officiel impots.gouv.fr propose une rubrique dédiée aux donations (https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/donations) où l’on trouve les explications et liens vers les services en ligne. Il est crucial de respecter les délais (par exemple le délai de 3 mois pour déclarer un acte étranger, ou d’un mois pour une révélation de don manuel) afin d’éviter des majorations. En cas de retard dans la déclaration d’une donation imposable, l’administration peut appliquer une pénalité de 10 % (voire plus si le retard est très important ou délibéré).
Notons enfin que si une donation étrangère a déjà été taxée dans l’autre pays, il faudra le mentionner dans la déclaration française et fournir les justificatifs du paiement à l’étranger. Cela permettra, le cas échéant, de bénéficier de l’imputation prévue par l’article 784 du CGI : la somme des droits étrangers payés sur les biens non situés en France sera déduite du calcul des droits français (dans la limite de ces derniers). Cette imputation, lorsqu’elle est applicable, se réalise via le formulaire spécifique (Cerfa 2740) à déposer auprès du Service des impôts des non-résidents. Si la convention fiscale applicable prévoit un crédit d’impôt différent, il faudra se conformer aux modalités du traité. En tout état de cause, il est recommandé de se faire assister par un conseil fiscal lors de ces démarches afin d’optimiser les déclarations, de ne pas omettre les demandes de crédit d’impôt et de se conformer aux exigences des deux pays concernés.
Le rôle de l’avocat fiscaliste dans la sécurisation des donations internationales
Face à la complexité des donations internationales, le recours à un avocat fiscaliste expérimenté est vivement conseillé pour sécuriser l’opération et en optimiser le traitement fiscal. Un avocat fiscaliste, en lien si nécessaire avec un notaire et des correspondants à l’étranger, va accompagner le donateur et le donataire à chaque étape :
- Conseil en amont et structuration de l’opération : L’avocat analyse la situation familiale et patrimoniale, identifie les pays impliqués (résidence des parties, localisation des biens) et les règles fiscales de chacun. Il détermine si une convention fiscale s’applique et, le cas échéant, comment celle-ci répartit le droit d’imposer. Sur cette base, l’avocat pourra proposer des stratégies pour éliminer ou réduire la double imposition. Par exemple, il pourra conseiller de choisir le bon lieu de réalisation du don (acte en France ou à l’étranger), ou de loger certains biens dans une structure juridique (société holding, trust/fiducie, etc.) afin de bénéficier des dispositions conventionnelles ou de contourner un écueil fiscal (comme dans le cas franco-belge, où l’on peut envisager de donner les titres via une société intermédiaire belge afin d’éviter l’imposition française directe sur des titres considérés comme situés en France). L’avocat pourra également planifier l’utilisation des abattements (par exemple en échelonnant plusieurs donations sur les années, ou en combinant donation et démembrement de propriété pour réduire la base taxable).
- Maîtrise des risques juridiques et fiscaux : Un bon conseil doit anticiper non seulement l’impôt à payer immédiatement, mais aussi les conséquences à long terme. L’avocat fiscaliste veillera à la conformité de l’opération avec les législations des deux pays (pour éviter qu’une manœuvre soit requalifiée en abus de droit). Il s’assurera que la donation respecte également le droit civil (par exemple les règles impératives de réserve héréditaire en France ou à l’étranger, qui pourraient remettre en cause le don lors de la succession du donateur). En matière de conventions fiscales, il vérifiera les critères de domicile fiscal, éventuellement en faisant jouer les clauses de “tie-breaker” (si le donateur est considéré résident des deux pays, les conventions prévoient des critères pour trancher). Cette analyse fine permet de sécuriser juridiquement la donation internationale, ce qui est essentiel pour éviter des litiges futurs avec l’administration ou entre héritiers.
- Réalisation des démarches et formalités : L’avocat fiscaliste peut prendre en charge la préparation et le dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales nécessaires en France, en coordination si besoin avec un conseil local à l’étranger pour les obligations dans l’autre État. Il saura quel formulaire utiliser (2735, 2734, etc.) et comment le remplir en mentionnant, par exemple, l’application d’une convention ou la demande de crédit d’impôt pour impôt étranger déjà payé. En cas d’acte notarié étranger, il guidera le client pour transmettre les informations au Service des impôts des non-résidents dans les délais impartis. Son rôle est également d’éviter les erreurs (une case mal cochée, un oubli de mention, peut coûter cher) et de négocier avec l’administration si nécessaire (par exemple pour solliciter un paiement fractionné, ou défendre un point d’interprétation d’un traité fiscal).
- Contentieux et contrôle fiscal : Si l’administration française remet en cause le traitement appliqué (par exemple, conteste l’interprétation d’une convention ou l’évaluation des biens donnés) et émet un redressement, l’avocat fiscaliste est le mieux placé pour assurer la défense du contribuable. Il pourra argumenter dans le cadre d’une procédure amiable (réclamation, demande à l’amiable d’élimination de double imposition internationale via la procédure amiable prévue dans les traités) ou contentieuse (recours devant les tribunaux). De même, en cas de double imposition effective, l’avocat peut assister le contribuable pour activer la procédure amiable internationale entre États prévue par certaines conventions fiscales afin de résoudre le différend (par exemple, faire dialoguer la France et l’autre pays pour qu’ils s’accordent sur une répartition de l’imposition ou un dégrèvement).
En somme, l’avocat fiscaliste apporte une vision globale englobant à la fois le droit interne français, le droit étranger applicable, et les conventions internationales. Son expertise permet de sécuriser l’opération de donation internationale, d’éviter les pièges (fiscaux et juridiques) et souvent de réaliser des économies d’impôt légales en utilisant au mieux les textes. Il agit en complément du notaire : tandis que le notaire instrumente l’acte et veille au respect des règles civiles (validité du don, consentement, réserve héréditaire…), l’avocat fiscal se concentre sur l’optimisation fiscale, la conformité internationale et la défense en cas de litige. Pour des donations impliquant des pays à haute fiscalité (par ex. la France dont les taux sont parmi les plus élevés de l’OCDE) ou une situation transfrontalière atypique, son accompagnement est quasiment incontournable.
Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts, conseil, assistance et contentieux fiscal. 24 rue de Madrid 75008 Paris. Tél : 01 43 87 88 91. patrickmichaud@orange.fr
11:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
08 février 2026
PACS et abus de droit fiscal ( 2 avis du CADF)
Créé en 2007 ,le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe.Il permet d'organiser leur vie commune.
Il est defini aux articles 515-1 et suivant du code civil
Le PACS beneficie d un regime successoral privilegie : les sommes revenants au conjoint Pacse sont totalement exonérées de droits de succession (CGI art. 796-0 bis).
BOFI Successions entre époux ou entre partenaires liés par un PACS
Certains peuvent donc contracter un PACS pour des raisons exlusivement fiscales !!!
Le Centre Notarial d’Assistance Fiscal avait publie en mai 2023 une etude interrogative sur ce problème
Pacs de complaisance et risque d'abus de droit ! Stéphanie Meignin 11 mai 2023
Le comite des abus de droit fiscal a en 2025 donné son avis dans deux affaires
Avis négatif Affaire n° 2024-35 M. C
(séance n°1 CADF 1-2025 du 3 avril 2025.odt)
Le Comité estime au vu du dossier soumis à son appréciation et des précisions apportées lors de la séance, que l’administration n’apporte pas la preuve, par les éléments dont elle se prévaut, que le pacte civil de solidarité n’a été conclu qu’en vue d’atteindre un résultat étranger aux buts pour lesquels le législateur l’a institué et présente ainsi un caractère fictif et que, par suite, elle n’est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Nota : l’administration a décidé de suivre l’avis émis par le comité
Avis positif affaire n° 2025-12 .
(séance n°9 du 11 septembre 2025.odt)
Le 11 septembre 2025, le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) a rendu un avis marquant : il valide la procédure d'abus de droit engagée par l'administration fiscale à l'encontre d'un pacte civil de solidarité (PACS) qualifié de fictif
iale
15:45 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
07 février 2026
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat
 Avocat fiscaliste international,
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008
Portable 06 07 269 708
De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Une succession internationale se définit comme une succession dans laquelle le défunt a des biens ou des héritiers dans un État autre que celui de sa résidence. Elle pose parfois des problèmes fiscaux complexes, dont l’étude est l’objet du présent article.
Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
La plupart des Etats ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse d’autres pays.
Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Etats-Unis, la Finlande, l’Italie, le Portugal, la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).
Troisième situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahrein, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les Emirats arabes unis, le Koweit, le Liban, le Maroc, le Qatar, le Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..
En consequence , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Les trois critères alternatifs de l imposition
EN FRANCE
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite
16:21 | Tags : fiscalite des successions internationales . patrick michaud avoc | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
31 janvier 2026
L'INTERET GENERAL A T IL UNE VALEUR CONSTITUTIONNELLE donc superieure aux traites ?
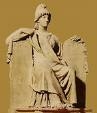
l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
tel 0033 (0)607269708
la question se pose notamment dans le cadre du mercosur?
CET ACCORD EUROPEEN POURRA T IL ETRE REJETE PAR LA FRANCE POUR MOTIF D INTERET GENERAL,,
AUTRES EXEMPLES
Biogaran change de mains : le fonds BC Partners finalise le rachat auprès de Servier cliquer
Bercy a tranché en faveur du rachat de Biogaran par le britannique BC Partners. Emblème de la production de génériques en France, l'industrie promet de conserver le siège et des emplois en France. Mais cette décision ravive la question de la souveraineté sanitaire déjà mise à mal
Novembre 2024
le motif d interet general est t il un droit constitutionnel ?
Notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif, La référence à l’intérêt généra apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise. La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).
Le colloque au Conseil d 'Etatdu 28 novembre 23 fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).
Enfin, la confrontation avec les droits fondamentaux soulève de nouvelles questions : l’intérêt général absorbe-t-il les droits fondamentaux ou bien les droits fondamentaux, s’opposent-ils à l’expression de l’intérêt général ?
LA REPONSE EST IMPORTANTE NOTAMMENT TPOUR EVITER QUE L ACQUEREUR D'UNE ENTREPRISE UTILISE LA JURISPRUDENCE ZIMMER QUI PERMER DE DELOCALISER CERTAINES ACTIVITES FRANCAISES
Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international
colloque sur l’intérêt général Conseil d’état novembre 2023
l’emploi de la notion d’intérêt général, souvent par son caractère fruste qui permet de contrebalancer un droit toujours plus spécialisé, est un outil essentiel à la qualité du contentieux.
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
L'intérêt général, norme constitutionnelle ?
Noëlle Lenoir - Membre honoraire du Conseil constitutionnel 2006
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
DIVIDENDES REQUALIFIES EN SALAIRES :L'URSSAF SUIT LA DGFIP (CA Aix3.07.25)
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite 
patrickmichaud@orange.fr
Des revenus dits distribués peuvent etre requalifiés en salaires tant au niveau fiscal que social
AU NIVEAU SOCIAL la suite en bas
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
AU NIVEAU FISCAL
l' introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées en novembre 2024 est premonitoire
"Vouloir transformer des salaires en dividendes, soumis à un régime fiscal plus favorable, peut amener les contribuables à payer une addition salée sur le terrain de l’abus de droit, lorsque l’administration parvient à démasquer l’artifice, ainsi que l’illustrent les présents pourvois. "
Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..
Telle est l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées en novembre 2024
L’ affaire CARMIGNAC GESTION
la première convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)pour fraude fiscale
la jurisprudence du conseil d etat
N° 487706 - M. H... N° 487707 – M. C... N° 487793 – M. L...
conclusions de Mme Céline GUIBE,
A la suite de vérifications de la comptabilité des deux sociétés françaises, CGSA et CDIF, et de contrôles sur pièces des intéressés personnes physiques, l’administration fiscale a considéré que ce montage avait été mis en place pour maquiller en dividendes la rémunération versée à ceux-ci par la société CGSA au titre de l’activité opérationnelle de promotion internationale des produits Carmignac Gestion qu’ils exerçaient en leur qualité de mandataire et/ou de salarié de cette société. Mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF, elle a écarté l’interposition des sociétés luxembourgeoises et de la société CDIF, ainsi, le cas échéant que des holdings patrimoniales, pour imposer les sommes en cause directement entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires
AU NIVEAU SOCIAL
LA CHARTE DU COTISANT CONTROLE (source urssaf 2024)
Pour la 1er fois,une cour d appel confirme un redressement de l’urssaf qui remet en cause un montage fiscalo social permettant de transformer une rémunération en dividende et donc d’eviter de payer les charges sociales salariales
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
Cet arrêt va continuer le débat
Se rémunérer sous forme de dividendes : inconvénients et dangers
Par Thibaut Clermont
Simulateur dividendes ou rémunération du dirigeant - OptiRev
3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530
En 2013 et 2014, une SAS a conclu deux conventions de prestations de services avec sa société mère, une SARL unipersonnelle, détenue et dirigée par son président.
La SAS vesrait donc des dividendes a sa mere , dividendes qui benéficiaient du regime fiscale de societes meres L’URSSAF a considéré que les conventions en cause avaient pour seul objet de rémunérer - indirectement - le dirigeant de la SAS, sans contrepartie réelle distincte des missions qui étaient les siennes à raison de son mandat social. Et ce payer les cotsations sociales obligatoires Elle a donc opéré un redressement au titre de son assujettissement au régime général, fondé sur les articles L.311-3 (assujettissement des dirigeants) et L.242-1 (prise en compte de tous les avantages) CSS. Le contribuable soutenait que le redressement était irrégulier en ce que l'URSSAF, qui contestait finalement la réalité des contrats de prestations, aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit social et lui accorder les garanties attachées. La Cour juge que la requalification opérée par l'URSSAF ne nécessite pas l’application de la procédure d'abus de droit dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les contrats étaient fictifs ou que la société poursuivait exclusivement un objectif d’atténuation des charges sociales : "la seule divergence entre la société cotisante et l’URSSAF sur l’application de la règle de l’affiliation du travailleur concerné n’a pas à s’analyser comme relevant de l’abus de droit". Sur le fond, la Cour relève notamment que : – les prestations listées dans le contrat (management, stratégie, validation technique, relations commerciales, etc. - voir en commentaires) recouvraient celles normalement dévolues au dirigeant de la SAS ; – le contrat, intuitu personae, mentionnait expressément que l’exécution était confiée au dirigeant en considération de ses compétences propres ; – aucune autonomie de la SARL prestataire n’était démontrée (pas de moyens, pas de personnel, pas d’indépendance opérationnelle) ; – les factures correspondaient en réalité à l’activité du dirigeant au sein de sa propre société, non à des prestations distinctes. La Cour juge donc que les contrats étaient dépourvus de cause et que "la nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d’entreprise". Elle valide l’assujettissement des sommes versées par la SAS à la SARL aux cotisations du régime général, comme rémunération du dirigeant. La demande de réduction du redressement fondée sur les cotisations versées en qualité de travailleur indépendant dans la SARL est rejetée : la Cour rappelle que la personnalité morale de la SAS est distincte de celle de son dirigeant, et que l’obligation de cotisation repose sur la société employeuse.
AUTRES SITUATIONS
Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE
Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
10:22 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
28 janvier 2026
Siege effectif de direction en France ‘CAA VERSAILLES 8.01.26 et CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Patrick MICHAUD 0607269708
LE SIEGE SOCIAL N’EST PAS
DE DROIT
LE LIEU DE DIRECTION EFFECTIVE
mise a jour janvier 26
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165
Une holding a été constituée au Luxembourg par un groupe familial français afin de détenir plusieurs sociétés opérationnelles du groupe.
Après des perquisitions l’administration fiscale a estimé que le siège social luxembourgeois était fictif et que la société était en fait dirigée par un resident seul dirigeant de fait, depuis son domicile francilien
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165,
Au-delà de son activité de détention de participations la holding gérait un portefeuille d'actifs incorporels pour le compte du groupe et réalisait des bénéfices tirés de redevances de concession de brevets.
L’administration a redressé la société à l’IS et à la TVA sur les années 2012 à 2017 en estimant que son siège de direction était situé en France et qu’elle y avait donc un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
Conseil d'État N° 449723 10ème - 9ème chambres réunies 15 mars 2023
Les conclusions didactiques de M. Laurent Domingo, rapporteur public
Dans une décision du 15 mars 2023 le conseil d etat précise à nouveau les conditions du lieu de direction effective d’une société dont le siège social est à l étranger
Cet décision est intéressante car elle permet à l’administration de remettre facilement en cause les schémas à la tournesol de sociétés offshore alors que le dirigeant, mal conseillé, reste en France dans son fauteuil mais devant son écran ???
Le conseil confirme
CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention
(CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Réidence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective
( Cnie des wagons lits (BE) CE 7/03/16 +conclusions Bretonneau
DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE
Le comité des affaires fiscales de l’OCDE,
dans ses commentaires de 2008, estimait que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité dans son ensemble.
Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte
Commentaires OCDE sur la residence fiscale
L’expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
24 Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité. Le siège de directive effective sera d'ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend officiellement ses décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble
ANALYSE DES FAITS
CAA MARSEILLES 18MA01293 du 15 décembre 2020
- E..., domicilié en France, est administrateur et actionnaire de la société « CA Animation », holding du groupe « CA Traiteur & Salaisons ».
Cette société a été créée en France en 2002 avant de devenir,par transfert de siege une société anonyme de droit luxembourgeois en 2005.
A l’occasion d’une vérification de comptabilité de l’établissement stable en France de cette société, portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que la société avait son centre de direction effective en France.
Elle en a tiré les conséquences au niveau de M. E... en rectifiant son niveau d’imposition sur le revenu tant à raison des dividendes que des tantièmes qui lui ont été versés en 2010 et 2011 par cette société.
la société ne disposait au Luxembourg que d'un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation.
Elle n'y employait qu'un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d'autres sociétés du groupe par le requérant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Par suite, et alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, son centre effectif de direction se situait en France.
En l’espèce, pour juger que le centre de direction effective de la société CA Animation devaitêtre fixé en France, la cour s’est fondée, d’abord, sur la faiblesse des moyens humains et matériels de la société au Luxembourg.
LA COUR a relevé que la société CA Animation a signé un bail avec la société Aurea Finance Company, dont l’une des activités est la domiciliation d’entreprises, lui permettant de disposer d’un local de seulement 13 m², au 50 rue Basse à Steinsel, qui est également l’adresse du siège social de la société bailleresse. Le seul dministrateur de la société CA Animation au Luxembourg était un dirigeant de cette société Aurea Finance Company. Le comptable de la société CA Animation, employé pour 10 heures par semaine, était aussi un des salariés de la société Aurea Finance Company.
La cour s’est ensuite fondée sur l’importance des moyens mobilisés en France, au 49 avenue d’Iéna à Paris, pour la gestion financière, comptable et fiscale de la société CA Animation. C’est à cette adresse que sont établies plusieurs des sociétés composant le groupe. La cour a relevé que des ordres de mouvement de titres et des ordres de virement bancaires de la société CA Animation étaient émis depuis le 49 avenue d’Iéna, que les relevés périodiques des comptes bancaires détenus par la société CA Animation dans les établissements HSBC, BNP Paribas et Banque de Luxembourg, étaient envoyés au cabinet comptable Aurion, situé 15 avenue de l’Opéra à Paris, et que ce cabinet était destinataire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société CA Animation avant leur dépôt au Luxembourg.
La cour a enfin constaté que les deux cofondateurs et administrateurs de la société CA Animation, qui détiennent chacun 50 % de son capital, qui sont statutairement habilités à engager la société, et sont par ailleurs mandataires sociaux des sociétés du groupe exerçant leur activité en France, sont domiciliés en France où ils ont signé de 2007 à 2011 des conventions cadres d’apport d’affaires et des avenants avec différentes sociétés du groupe
10:19 | Tags : siege de direction effective patrick michaud 0607269708 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
24 janvier 2026
LE BON IMPOT : assiette large et taux faible / Le message de Christine LAGARDE (2008) reste toujours d'actualité

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
patrickmichaud@orange.fr
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
.EFI rediffuse les travaux de bon sens effectués en 2008
Ce livret, qui s'intitule « document d'orientation sur les évolutions de la politique fiscale » est le résultat de la revue générale des prélèvements obligatoires demandée, le 28 septembre 2007, par Nicolas Sarkozy, à la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Christine Lagarde.
«La mission que j'ai reçue (...) est de bâtir une stratégie fiscale à taux de prélèvements obligatoires constant. D'ici à 2012, la priorité absolue est d'éliminer le déficit public, elle n'est pas de baisser les impôts. La situation de nos finances publiques nous l'interdit.» C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Economie, Christine Lagarde, dans une interview parue vendredi 28 juillet 2008 dans «Les Echos»
Rédigé pour l'essentiel par Alain Quinet, inspecteur des finances ce document « vise à favoriser la construction, sur la législature, d'une stratégie fiscale lisible et cohérente ». Un exercice conduit sous une forte contrainte, celle de ramener, d'ici à 2012, «, « le solde public à l'équilibre et la dette à 60 % du PIB ». L'objectif n'est donc pas d'abaisser la pression fiscale globale.
« Si notre pays veut renouer durablement avec une croissance forte (...),
il doit faire de son système de prélèvements obligatoires un atout et non un handicap, même si cela implique des réformes difficiles »
NOUS ETIONS EN 2008
MAIS CE RAPPORT EST ENCORE PLUS D ACTUALITE EN 2026
Le niveau et la structure des prélèvements obligatoires doivent être évalués à l’aune de trois enjeux principaux
Le premier critère est celui de l’efficacité
en règle générale, les impôts à assiette large et taux faible sont jugés plus efficaces économiquement que des impôts à assiette étroite et taux élevé ;
L’équité est la deuxième propriété essentielle d’un système fiscal.
UN NOUVEAU DEBAT EN PREVISION
Rapporteur général, Mr Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
La simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.
La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt
UN EXEMPLE DE COMPLEXITE l IMPOT SUR LE REVENU
LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018
De la case OAB à la case ZZA
La déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas être constitutionnelle ?
En effet
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789
- POURQUOI RÉFORMER LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS ?
1.1. Les grandes tendances
1.1.1. La mondialisation et la concurrence fiscale
La concurrence fiscale est d’abord le fait de nos voisins au sein de l’Union européenne et des autres pays développés, plutôt que de pays émergents
- L’impact du vieillissement de la population sur la répartition des prélèvements entre actifs et inactifs et le rythme de progression des dépenses sociales
le vieillissement de la population fragilise les modèles sociaux dont le financement repose principalement sur des prélèvements assis sur le facteur travail
Ces tendances signifient que le financement de la protection sociale ne peut plus reposer exclusivement sur la masse salariale et qu’une diversification des assiettes (entamée avec la mise en place de la CSG) est une option possible
1.2. Les défis plus spécifiquement propres à la France
1.2.1. Le diagnostic d’ensemble
La France se singularise par le niveau de son taux de prélèvements obligatoires (PO), qui s’élève à 43,9 % en 2006 contre 38,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE) à 15.
Les taux de prélèvements obligatoires du Royaume-Uni et de l’Allemagne s’établissaient au même niveau que le taux de prélèvements obligatoires de la France il y a 40 ans. Ils lui sont aujourd’hui inférieurs de 5 à 10 points.
Les deux tiers de l’accroissement des dépenses publiques enregistré en France sur la période 1970-2006 s’expliquent par le dynamisme des dépenses sociales.
Entre 1970 et 2005 :
− les dépenses de retraites sont passées de 7,3 % à 13,0 % du PIB ;
− les dépenses de santé sont passées de 5,3 % à 10,5 % du PIB.
L’évolution de la répartition des prélèvements obligatoires entre administrations publiques concorde avec celle des dépenses publiques. Sur la période 1966-2006 :
− les prélèvements obligatoires à destination des organismes de sécurité sociale ont doublé, passant de 11 % à 22 % du PIB ;
− les prélèvements obligatoires perçus par l’État ont été ramenés de 19,4 % à 16 % du PIB ; − les prélèvements obligatoires revenant aux collectivités territoriales ont progressé de 3,3 % à 5,6 % du PIB, principalement sous l’effet des transferts successifs de compétences.
De fait, par rapport à ses partenaires, la France se singularise avant tout par le poids des cotisations sociales, qui atteint 16,1 % du PIB en 2005, contre en moyenne 14,3 % du PIB dans la zone euro et 12,0 % dans l’Union européenne à 15.
Cette situation peut refléter les choix français concernant le système de protection sociale : − un niveau élevé de prise en charge par la collectivité ;
− un financement principalement assis sur le facteur travail.
Le niveau élevé des cotisations sociales ne s’accompagne pas pour autant d’un moindre niveau d’imposition directe ou indirecte :
− le poids de l’imposition directe des ménages et de l’imposition indirecte en France est du même ordre de grandeur que chez ses principaux partenaires de l’Union européenne ;
− le poids de l’imposition directe des entreprises en France est supérieur d’1,7 point à la moyenne de l’Union européenne à 15 (6,0 % contre 4,3 % du PIB)
16:31 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
23 janvier 2026
IMPOSITION DES PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER - Patrick MICHAUD
Vous cédez un immeuble, ou des biens assimilés, que vous possédez à l etranger le principe est que .la plus value est imposée dans l etat de situation de l immeuble mais est elle imposable aussi en France?
PATRICK MICHAUD Avocat fiscaliste,
O6 07 269 708 patrickmichaud@orange.fr
1 En l'absence de convention fiscale internationale signée entre la France et l'État d’implantation du bien immobilier, le problème est simple si l’on ose dire ! La plus-value réalisée suite à sa cession est imposable de la même manière que s’il était situé sur le sol français.
2 Si une convention fiscale existe entre la France et l’État de situation de votre bien immobilier, la plus-value est en principe imposable dans celui-ci. Mais « complication oblige »
La plus value value est aussi imposable en France SAUF SI la convention prévoit une imposition exclusive dans l etat de sitiuation
Dans une décision du 11 décembre 2020 , la conseil d etat a confirmé qu’ à défaut d’une mention d’imposition exclusive ( la clause du ne que )dans l état de situation de l immeuble , les plus values immobilières sont aussi imposables en France avec un credit d’impot étranger
L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.
En cas d’absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Un résident français qui cède un immeuble situé à l'étranger est en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien, imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France.
En cas de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,
Lorsqu'une convention fiscale est signée, elle prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés.
Quelques rares conventions stipulent que la plus value n’est imposable QUE dans Etat de situation de l immeuble
Liste des conventions internationales (cliquez).
Elle peut également prévoir une imposition en France en plus de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l’enregistrement):
Plus-values immobilières les BOFIP
ATTENTION
LE CALCUL DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE EST DIFFERENT ENTRE CELLE D’UN IMMEUBLE
ET CELLE DE PARTS D'UNE SPI
I Plus value de cession d’ immeuble ou de droits immobiliers
II Plus value de cession de parts de societe a preponderance immobiliere
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou au montant de l’impôt étranger sans que celui-ci puisse dépasser le montant de l’impôt français
Il est alors possible de déduire un crédit d'impôt du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.
Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, vous ne devez pas souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047
Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C.
11:38 | Tags : imposition des plus values immobilieres realisees a l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
21 janvier 2026
SUCCESSION INTERNATIONALE REGIME CIVIL ET FISCAL Patrick MICHAUD
 Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
24 RUE DE MADRID 75008 paris 0607269708
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES
La question ? Peux t on être non résident fiscal en matière d’IR et résident fiscal en matière de droits de succession ???
Le droit successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession
Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut pas être choisi et qui n’est pas partie du règlement européen
En France, l’imposition de la succession dépend du lieu de résidence du défunt ou de l’héritier. La définition du domicile fiscal successoral est régit soit par le droit interne soit par un traite spécialement négocié pour les successions .les traites concernant l imposition des revenus ne peuvent donc pas définir un domicile fiscal successoral sauf rares exceptions
Par exemple Une succession soumise au droit suisse reste donc imposable en France, dès lors que l’héritier réside fiscalement en France. au sens de l’article 4B du CGI
Une succession peut donc être soumise au droit civil du lieu de résidence civile au jour du décès , au droit de l imposition sur le revenu au lieu de sa résidence conventionnelle ET au droit fiscal interne pour les impôts de succession à défaut de convention fiscale successorale
SUCCESSIONS INTERNATIONALES
LES DOMICILES CIVILS ET FISCAUX en pdf cliquez
Les successions sont dites internationales losqu’un des paramètres suivants se trouve impliqué
-Quel est l état de situation des biens, meubles ou immeubles
-Quel l’etat d’ouverture de la succession et le ou les droits de dévolution de la succession applicables
Quel est l’état du domicile fiscal du défunt ?
-Existe-t-il une convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (cliquez) ou le règlement européen
-Existe-t-il une ou des conventions fiscales sur l’imposition du revenu et ou l’imposition des mutations à titre gratuit ?
-Quel sont le ou les etats du domicile fiscal des ayants droits, héritiers et légataires ?
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu et résident pour les droits de succession §§§
Lieu d’ouverture de la succession. 1
Les incidences civiles du droit ou des droits applicables. 2
Fiscalité des successions franco-suisses. 2
Comparaison des droits de succession. 2
Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale. 3
L’etat du Lieu d’ouverture de la succession
Le droit français
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
Le droit européen
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
COMPARAISON DES RÈGLES CIVILES ET FISCALES DANS L UNION EUROPEENNE
Les incidences civiles du droit ou des droits applicables
les règles civiles françaises ne s’appliquent en principe pas –pour les successions ouvertes à l’étranger sauf si des biens immobiliers - sont situés en France:: application éventuelle des règles d'ordre public du droit civil successoral français.
Le droit successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession. Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut être choisi
Les règles civiles françaises de succession
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
Circulaire du 25 janvier 2016 CLIQUEZ de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen
A titre d’exemple
Fiscalité des successions franco-suisses
Régime matrimonial et conséquences fiscales
Le règlement établit des critères de rattachement harmonisés pour déterminer le droit applicable aux régimes matrimoniaux, en plus de la compétence des juridictions compétentes pour statuer sur tous les aspects de droit civil des biens matrimoniaux. régimes, concernant à la fois la gestion quotidienne des biens du couple et la liquidation des biens matrimoniaux. Le règlement simplifie la reconnaissance et l'exécution des jugements ainsi que l'acceptation et l'exécution des actes authentiques liés aux régimes matrimoniaux.
Les explications des notaires de France
Les Incidences fiscales
Comparaison des droits de succession
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %. Et ce sans prendre en compte les abattements et franchised
Le droit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu et résident pour les droits de succession §§§
BOFIP successions internationales
– Champ d'application des droits de mutation par décès
- Territorialité de l'impôt
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Les conventions fiscales sur les successions
Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale
Précision administrative du 12.09.2012 §50
Pour qu'un redevable soit considéré fiscalement comme domicilié en France, il suffit qu'un seul des critères prévus par l’article 4 du CGI existe. Par exemple, les redevables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile fiscal dans notre pays, quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation.
Dans deux arrêts du 15 octobre 1996 (Cass. Com. n° 94-19120) et du 16 décembre 1997 (Cass. Com, n° 95-20365), la Cour de cassation a précisé que :
- les trois critères de détermination du domicile fiscal fixés par l'article 4 B du CGI sont alternatifs et indépendants les uns des autres ;
- l'appréciation du faisceau d'indices établissant la localisation du domicile fiscal relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En pratique, les agents chargés du contrôle des droits de mutation à titre gratuit devront, lorsqu'il y a doute sur le domicile fiscal en France des personnes concernées et que cette notion de domicile est déterminante pour fixer les règles d'imposition aux droits de mutation à titre gratuit, prendre l'attache de leur collègue chargé de l'imposition des revenus desdites personnes, sauf à tenir compte d'un changement éventuel de domicile qui aurait pu intervenir entre le 1er janvier et la date du fait générateur.
Le décès d’une personne peut avoir des conséquences fiscales en France tant en matière d’impôt sur le revenu qu en matière de droits de succession
En l’absence de conventions fiscales, la définition du domicile fiscal est identique en matiere d’impot sur le revenu et en matiere de droits de succession
En cas de conventions fiscales, il faut rechercher la convention applicable en matière d’impôts directs et celle en matière de succession, il s’agir en effet de conventions différentes
Une succession ouverte à l’étranger, c’est à dire si le décédé était domicilié à l'étranger au jour du décès peut avoir des incidences en France notamment si des héritiers sont domiciliés ou si des actifs sont situés en france en effet Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire
En cas de succession ouverte en France, l’ensemble des biens y compris situés à l’étranger sont imposables en France sous réserves des conventions fiscales internationale (CGI, art. 750 ter-1°)
En cas de succession ouverte à l étranger CGI, art. 750 ter-2° et 3° ;: des doits de succession peuvent être exigible en France si des héritiers sont domiciliés en France ou si des biens ,notamment des immeubles sont situés en France
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
Les principes de territorialité exposés ci-après visent l'ensemble des transmissions à titre gratuit (successions et donations) et ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.
- la notion de domicile fiscal (§ I) ;
- notion de biens situés en France et hors de France et immeubles détenus indirectement en France (§ II) ;
- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III) ;
- l'incidence des conventions internationales (§ IV).
QE AN 114333 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier rép du 8.05.12
Simulateur des droits de succession
Droits de succession 2019 : calcul, montant et simulateur - JDN
Le tableau de la territorialité fiscale cliquer
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession cliquer
le cas particulier des Biens mis en Trust
09:56 | Tags : fiscalite des successions internationales regime civil et fisca | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
17 janvier 2026
la pratique du ruissellement fiscal a elle ete efficace ??? IR ? IFI? TVA ?

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
patrickmichaud@orange.fr
Les débats sur des augmentations fiscales et sociales ont repris
Nous savons tous que la France est le pays dans lequel le poids des prélèvements obligatoires(Etat, sociaux , locaux et autres ) est le plus important des pays de l’ocde mais cette analyse purement factuelle n’a aucune signification sauf électorale sans une analyse détaillée de chaque prélèvement ET de chaque contrepartie ainsi que des considérables dépenses ,légales ou adminisratives (un exemple de dépense non publiée) , dites fiscales
Les prélèvements obligatoires en France
et dans la zone euro en 2024
Malgré une baisse de 2,4 points depuis 2016, le taux des prélèvements obligatoires (PO) de la France en 2024 (45,3 % du PIB selon Eurostat) reste le premier de la zone euro (à égalité avec l’Autriche si on soustrait les cotisations de retraite de l’Etat employeur). Il est supérieur de 4,4 points de PIB au taux moyen de la zone.
Les impôts sur la production, qui forment un ensemble hétérogène, contribuent pour 2,2 points à cet écart entre les taux de PO en France et dans la zone euro (dont 1,5 point pour ceux payés par les sociétés). Malgré la baisse engagée en 2021, la France est encore au premier rang de la zone.
Prélèvements obligatoires confiscatoires ; 10 decisions du conseil constitutionnel - et la theorie du ruissellemen
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
théorie du ruissellement,
1ere réflexion
la baisse des PO sur certains revenus
OU
l'acceptation de certains montages fiscaux comme en matiere de TVA extra communautaire (cliquez
est elle un ruissellement fiscal ?
le ruissellement permettrait d'accroitre les retombées sur les autres contribuables
« Trickle down theory » ou « théorie du ruissellement » Par Laurent Telo journaliste
selon cette théorie du ruissellement,« la relance économique ne s’obtient qu’en aidant la haute finance et la grande industrie », car la fortune ruissellera alors tout le long de la pyramide sociale,
La question que nous sommes nombreux à nous poser est de savoir quels ont ete les effets budgétaires et économiques notamment de la suppresson de l ISF et de la creation de l'IFU sur l evolution des taux marginaux sur les PO et de l exoneration de TVA pour les prestataires non communautaires ( cf McKinsey )???
2eme reflexion
la baisse des PO sur certains revenus ou capitaux a d'une part ete un appel d'air pour les etrangers et d'autre part pour eviter des departs fiscaux
Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital
– Rapport final Octobre 2023
Taxation du capital : le bilan 5 ans après la réforme
PAR Annabelle Pando journaliste
OCDE Taux effectifs d'imposition des revenus du travail
le taux marginal effectif de prélèvement
(INSEE (derniere etude 2017??°
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
les 10 décisions du conseil constitutionnel –
Les jurisprudences du conseil d etat et de la cour de cassation
un exemple à suivre ???
LE PLAN
Le fondement constitutionnel d’une imposition confiscatoire2
Modalités de détermination de l’imposition confiscatoire2
La capacité des pouvoirs publics à lever l’impôt3
L’avis du conseil d état du 21 mars 2013 sur les prélèvements confiscatoires4
Modalité pratique de saisine du conseil constitutionnel4
Des dispositions fiscales confiscatoires jugées non constitutionnelles4
1 l’imposition marginale maximale de 75,04 % pour les retraites dites « chapeau ». 4
2) le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus des bons anonymes. 5
3) les gains et avantages procurés par la levée de stock-options ou l’attribution gratuite d’actions. 5
4) le taux d’imposition marginal maximal de 82 % pour les plus-values immobilières. 5
5) Le taux d’imposition forfaitaire de 90,5 % sur les revenus générés par des instruments financiers à terme. 6
6) Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau ». 6
Des dispositions confiscatoires jugées constitutionnelles7
-7) La contribution exceptionnelle sur la fortune n’est pas confiscatoire. 7
-8)La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas confiscatoire. 7
Le but de lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 7
-9) la majoration de 1.25 sur les revenus irrégulièrement distribués est constitutionnelle (qpc 28.06.19 avec conclisions LIBRES d’E Victor devant le CE. 7
-10) la retenue à la source de 75% sur les produits versés à un Etat ou territoires non coopératifs ETNC( qpc 25.11.16+. 8
2ème Pilier Le Principe d’égalité devant les charges publiques. 8
3ème Pilier le Principe de non-rétroactivité. 10
Application aux sanctions fiscales. 11
Application aux droits en principal 11
, 11
4ème Pilier le Principe de la Garantie des droits. 11
5ème Pilier l’Objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi 12
II Les principe du droit de l’union européenne13
6ème Pilier Le respect du droit de l’Union européenne. 13
III Les principes de la convention européenne des droits de l homme15
7 eme pilier la convention européenne des droits de l homme. 15
IV La Jurisprudence de la cour de cassation17
Une imposition de 114% du revenu net n’est pas confiscatoire ??
(cass 12 mai 2021) 17
V L’ avis du conseil d etat du 21 mars 2013
sur les prelevements confiscatoires17
19:20 | Tags : la pratique du ruissellement fiscal a elle ete efficace | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 
14 janvier 2026
DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
 Patrick Michaud avocat fiscaliste
Patrick Michaud avocat fiscaliste
port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations sauf si une convention particulière existe
Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe
Simulateur des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Règle du taux effectif le BOFIP
Certaines conventions conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit ne permettent pas d'imposer les biens situés à l'étranger qui sont reçus par un résident de France d'un défunt ou donateur non-résident, mais autorisent la France à calculer l'impôt exigible en France à raison des biens héréditaires (ou donnés) imposables en France en vertu de ces conventions d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens imposables en vertu de la législation interne française.
Cette modalité particulière de calcul est connue sous le nom de taux effectif.
Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
20:29 | Tags : fiscalite donation internationale :une donation etrangere peut | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | | 



